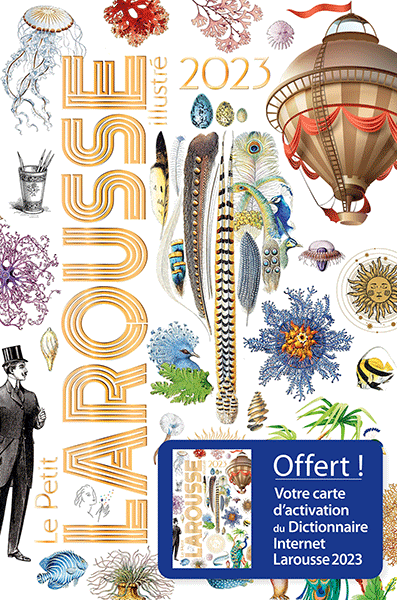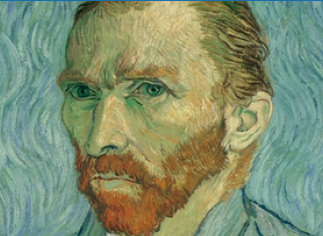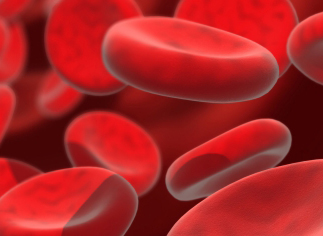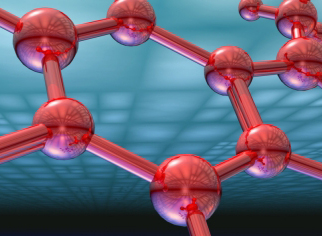Italie : vie politique depuis 1945
1. Le règne de la Démocratie chrétienne (1945-1976)
1.1. L'avènement d'un système républicain (1945-1948)
Les forces politiques en présence en Italie au lendemain de la guerre ont en commun leur opposition au fascisme, mais divergent sur la mise en œuvre du système politique.
Le parti d'Action, composé d'intellectuels, est orienté vers un socialisme libéral et est hostile à la monarchie. Tandis que les libéraux sont le seul groupe dirigeant dont l'influence populaire est restreinte, les communistes, eux, apparaissent comme la force politique la mieux organisée. Les socialistes penchent à cette époque pour la formation d'un parti unique des travailleurs. Enfin, sous la direction d'Alcide De Gasperi, la Démocratie chrétienne (DC) rassemble le noyau des anciens dirigeants « populaires » et les représentants de la nouvelle génération issue de l'Action catholique. La Démocratie chrétienne s'affirme dès les lendemains de la guerre comme la principale force de gouvernement en Italie. De Gasperi, qui sera président du Conseil jusqu'en 1953, forme, en décembre 1945, un gouvernement qui comprend les six partis issus de la Résistance. Les élections constituantes de juin 1946 (au suffrage universel étendu aux femmes) confirment la prédominance de DC, du parti communiste italien (PCI) et du parti socialiste italien (PSI). Le 2 juin, les Italiens se prononcent par référendum pour la république. Enrico De Nicola est alors nommé président de la République. Luigi Einaudi lui succédera en mai 1948, après l'élection de la première législature républicaine. Dans le deuxième gouvernement De Gasperi, formé en juillet 1946, entrent les républicains à côté des trois grands partis.
Mais le mécontentement des classes moyennes s'exprime aux élections communales de l'automne par la progression de l'Uomo Qualunque (Homme de la rue), alors que la Démocratie chrétienne perd des voix à Rome et à Naples. Dans ces deux villes, communistes et socialistes présentent des listes uniques, mais un certain nombre de socialistes, sous la conduite de Giuseppe Saragat, craignant d'être subordonnés aux communistes, fondent, en 1947, le parti socialiste des Travailleurs italiens (PSLI), qui deviendra le parti social-démocrate italien (PSDI). Après cette scission, De Gasperi constitue un nouveau gouvernement qui ne fait appel qu'à des représentants des trois grandes formations. Ce gouvernement tombera en mai 1947 à la suite de l'opposition des communistes à l'aide américaine obtenue par De Gasperi. En mai 1947, les communistes et les socialistes quittent le gouvernement, qui s'élargit en décembre aux sociaux-démocrates et aux républicains, marquant ainsi les débuts d'une alliance systématique qui sera à la base du nouvel État.
La Constitution, qui entre en vigueur le 1er janvier 1948, est largement inspirée par la Démocratie chrétienne, qui y introduit sa conception de l'autonomie locale et de la décentralisation des pouvoirs.
Durement touchée par la guerre, l'Italie doit se tourner vers l'étranger pour se lancer dans une politique de reconstruction. Après la première aide fournie par le gouvernement militaire allié, De Gasperi se consacre au relèvement économique de l'Italie avec l'aide des crédits américains fournis par le plan Marshall. Parallèlement, l'Italie doit accepter en février 1947 un traité de paix aux conditions particulièrement dures : cession à la Grèce du Dodécanèse et à la Yougoslavie de Zara, de l'île de Pelagosa et de l'Istrie, sauf Trieste, confiée à l'ONU. Le Haut-Adige devient région autonome, et les frontières franco-italiennes sont rectifiées (cession de La Brigue et de Tende). L'Italie abandonne tous ses territoires d'outre-mer (Éthiopie, Érythrée, Somalie, Libye). Enfin, sur le plan militaire, l'armée est limitée à 250 000 hommes.
1.2. L'ère De Gasperi (1948-1953)
La Démocratie chrétienne obtient la majorité absolue aux élections législatives du 18 avril 1948 et De Gasperi peut pratiquer une politique de collaboration avec les sociaux-démocrates, les républicains et les libéraux en dépit de l'opposition du nouveau parti néofasciste, le Mouvement social italien (MSI), des communistes et des socialistes. Mais, dès 1950, les libéraux se retirent du gouvernement en raison de leur hostilité à la réforme agraire, et, en 1951, les sociaux-démocrates ne participent pas à la formation du septième gouvernement De Gasperi. Une vaste réforme agraire est lancée pour résoudre la crise structurelle du Mezzogiorno.
D'autre part, l'Italie tente de sortir de son isolement diplomatique : elle adhère dès 1949 au pacte de l'Atlantique et liquide ses litiges avec l'Autriche en octroyant la nationalité autrichienne aux habitants du Haut-Adige, et avec la Yougoslavie (accords de 1951, récupération de Trieste en 1954). En avril 1951, la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) impose à l'Italie une restructuration de sa sidérurgie. Au cours de cette période, la production industrielle progresse avec une moyenne annuelle de 10 %.
À l'intérieur, si la politique de la première législature est à l'origine du boom économique, les résultats sont bien moins importants dans la constitution du nouvel État italien : la Cour constitutionnelle et le Conseil national de l'Économie et du Travail ne sont créés qu'en 1956 ; les divers codes, avec leurs dispositions fascistes, survivent encore tandis que la loi Scelba de 1953 sur l'organisation régionale apparaît largement insuffisante.
En juillet 1948, la grève générale marque la rupture syndicale et porte à trois le nombre de centrales ouvrières : la Confederazione generale italiana del Lavoro (CGIL), [communiste], la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) [syndicalisme chrétien] et l'Unione italiana del Lavoro (UIL)[radicaux et républicains]. Dans la Démocratie chrétienne, l'apparition d'une droite interne provoque des pertes électorales graves, notamment en faveur des néofascistes (MSI) et de la droite monarchiste, aux élections municipales de 1951 et de 1952. En outre, la coalition gouvernementale apparaît de plus en plus fragile. La loi électorale majoritaire qui remplace la proportionnelle pure n'atteint pas son but de renforcer la coalition gouvernementale centriste. Et, aux élections générales de juin 1953, il manque 57 000 voix à la coalition pour atteindre la majorité absolue.
1.3. Vers l'ouverture à gauche (1953-1958)
Les élections de juin 1953 marquent la fin de l'ère De Gasperi. Ce dernier forme un huitième gouvernement homogène démocrate-chrétien ; mais le cabinet tombe dès le 28 juillet. Se succèdent alors des formations diversement orientées : gouvernement démocrate-chrétien présidé par Giuseppe Pella (août 1953), puis par Amintore Fanfani (janvier 1954), retour au centrisme et au quadripartisme avec les gouvernements Mario Scelba (février 1954) et Antonio Segni (juillet 1955). Après le retrait de Giuseppe Saragat et la chute de ce dernier gouvernement, Adone Zoli forme un gouvernement homogène démocrate-chrétien, mais obtient une majorité grâce aux voix des néofascistes. Zoli se maintient cependant jusqu'aux élections générales de 1958.
En juillet 1954, De Gasperi (qui meurt le mois suivant) laisse son poste de secrétaire de la DC à Fanfani tandis qu'une nouvelle classe dirigeante accède à la tête du parti après le congrès de Naples (juin 1954). De leur côté, les socialistes de Pietro Nenni, au congrès de Turin (1955), préconisent le « dialogue avec les catholiques ». L'élection en avril 1955 d'un président démocrate-chrétien, Giovanni Gronchi, partisan de l'ouverture à gauche, illustre une première évolution de la Démocratie chrétienne.
Dans le sillage de la déstalinisation (rapport Khrouchtchev, 1956), les communistes italiens soulignent leur originalité en définissant une voie italienne au socialisme. Cependant, l'intervention soviétique en Hongrie (novembre 1956) provoque des remous à l'intérieur du PCI, qui perd 300 000 adhérents, et entraîne la rupture avec les socialistes.
Aux élections de 1958, le parti démocrate-chrétien renforce ses positions en remportant 273 sièges sur 596, et le PCI, avec 140 sièges, en perd 3. Avec 24 sièges à la Chambre et 9 au Sénat, le MSI constitue une force politique importante.
1.4. L'ère Fanfani (1958-1963)
Amintore Fanfani, leader de la Démocratie chrétienne, forme alors avec le PSDI un ministère baptisé pour la première fois de « centre gauche », même si Saragat, qui accepte 4 portefeuilles pour les membres de son parti social-démocrate, refuse de rentrer dans le gouvernement. Mais l’année suivante, tandis que le PSI se détache toujours plus du PCI à l’occasion de son congrès de Naples, Fanfani doit affronter des oppositions à l’intérieur de son gouvernement mais aussi de son parti dont il démissionne du poste de secrétaire général en même temps que de celui de président du Conseil. Le courant majoritaire au sein de la DC – « Initiative démocratique » – se scinde en deux avec la dissidence des « dorotei » (« Dorothéens », du nom du couvent des sœurs de Sainte-Dorothée dans lequel les chefs de ce courant s’étaient réunis) menée notamment par Segni – qui a formé un gouvernement DC soutenu par le parti libéral – Mariano Rumor et Aldo Moro. En octobre 1959, alors que la question de l’alliance à gauche est au cœur du congrès de la DC à Florence, ce courant l’emporte sur les partisans de Fanfani qui est remplacé à la tête du parti par A. Moro. Cette mouvance modérée reste hétéroclite mais devient dès lors le nouveau ciment du parti pendant une dizaine d’années.
Sur le plan social, le gouvernement Segni doit affronter une certaine agitation syndicale et, en outre, une mobilisation de la population de souche germanique dans le Haut-Adige. En 1960, le président de la République se rend à Moscou, où il rencontre Nikita Khrouchtchev, et, dès son retour, le parti libéral retire son soutien au gouvernement, provoquant la chute de Segni. Après le gouvernement Tambroni (qui ne dure que 4 mois) Fanfani redevient président du Conseil et obtient à la Chambre une large majorité (juillet).
Fanfani et Moro, qui s'étaient affrontés lors du précédent congrès de la DC, s'entendent finalement sur la nécessité d'un rapprochement avec la gauche non communiste alors qu'en janvier 1962, la majorité de la direction du PSI décide de suivre Nenni, favorable à cette alliance avec la DC. De son côté, cette dernière officialise l'ouverture à gauche lors de son 8e congrès à Naples. Le nouveau gouvernement Fanfani, formé en février 1962, comprend des démocrates-chrétiens, des sociaux-démocrates et des républicains, et obtient la confiance du Parlement. En mai, Segni est élu de justesse président de la République devant Saragat. S’ils se sont abstenus lors du vote d’investiture, les socialistes appuient la politique réformiste de Fanfani qui se lance dans une politique d'expansion économique et de promotion sociale dans le cadre du « plan Vanoni ». En juin 1962, l'ensemble des compagnies de distribution de l'électricité est nationalisé pour former l'Ente Nazionale de Elettricità (ENI). Mais la situation sociale se dégrade. La hausse des loyers, des tarifs de chemin de fer et des impôts au début de 1963 déclenche des grèves massives.
1.5. L'ouverture à gauche et la montée du parti communiste (1963-1968)
Les élections d'avril 1963 sont marquées par une forte progression du PCI, qui gagne 26 sièges, ainsi que du parti de Saragat (33 sièges au lieu de 22). La DC perd 13 sièges, tandis que le parti libéral progresse (39 sièges au lieu de 17), profitant de la peur d'une partie de l'électorat démocrate-chrétien devant l'« ouverture à gauche ». Après l'échec de A. Moro pour former un gouvernement de centre gauche, Giovanni Leone préside un gouvernement homogène démocrate-chrétien (19 juin-5 novembre 1963). Ce n'est que le 5 décembre que A. Moro peut présenter un gouvernement de centre gauche, après le 35e congrès du PSI en octobre, qui s'est déclaré en faveur de l'entente avec la DC. Nenni devient vice-président du Conseil et Saragat ministre des Affaires étrangères. L'une des conséquences de la participation des socialistes (PSI) est la formation du parti socialiste italien d'unité prolétarienne (PSIUP), issu de l'aile gauche du parti.
Une série de mesures d'austérité est décidée pour faire face à la crise économique et financière (février 1964). Puis, le 26 juin, A. Moro démissionne à la suite de la publication d'un texte selon lequel le président du Conseil serait en désaccord avec les socialistes sur les réformes économiques. Le deuxième cabinet Moro doit adopter un plan de stabilisation. En outre, la coalition souffre de l'opposition sourde de l'aile gauche des socialistes. Après la démission de Segni, souffrant, Saragat est élu, avec difficulté, président de la République, le 28 décembre 1964. Luigi Longo devient secrétaire général du PCI après le décès de Palmiro Togliatti (23 août). Chez les démocrates-chrétiens, Mariano Rumor est élu secrétaire général. A. Moro, parvenu à surmonter une grave crise gouvernementale provoquée par la démission de Fanfani en décembre 1965 du ministère des Affaires étrangères, forme, en février 1966, son troisième gouvernement de centre gauche. Le 30 octobre 1966, la réunification du PSI et du parti social-démocrate italien donne naissance au parti socialiste unifié. Nenni est élu président de tous les socialistes. Certains membres de l'ancien parti socialiste démocratique refusent cependant d'entériner une telle décision et fondent l'Union socialiste démocratique.
1.6. L'agitation sociale (1968-1976)
La stabilité gouvernementale est remise en question par les élections générales de mai 1968 : le parti socialiste unifié n'obtient que 91 sièges, l'ensemble de la droite recule, tandis que l'extrême gauche connaît un succès notable. Le refus des socialistes de participer à une coalition gouvernementale entraîne la chute du ministère Moro en juin.
Giovanni Leone forme un gouvernement homogène le 24 juin 1968, tandis qu'une agitation sociale et universitaire gagne l'Italie. Au congrès socialiste d'octobre, Nenni est violemment critiqué par la gauche de son parti. Le 14 novembre, une grève touche 12 millions de travailleurs et oblige le gouvernement Leone à démissionner. Cependant, alors qu'une grève générale vient de paralyser Rome en décembre, un accord de coalition de centre gauche entre la DC, les socialistes et les républicains permet à Rumor de former un gouvernement comprenant des représentants des trois partis. Mais l'agitation sociale persiste. Au début de juillet 1969, le PSI se scinde de nouveau malgré les efforts de Nenni, ouvrant ainsi une nouvelle crise gouvernementale. Le 11 août, Rumor forme un cabinet homogène qui tient compte de tous les courants de la seule DC. Le mouvement étudiant et ouvrier qui s’est intensifié, culmine à l’automne 1969 (« l'automne chaud »), tandis que l’attentat de Piazza Fontana à Milan (12 décembre) signe le début d’un terrorisme d’extrême droite.
La DC ne pouvant durablement diriger seule, Rumor parvient, après de longues négociations, à faire investir en avril 1970 un gouvernement comprenant 17 démocrates chrétiens, 6 socialistes, 3 socialistes unitaires et 1 républicain. Après une nouvelle crise ministérielle (6 juillet-6 août 1970), Emilio Colombo forme un nouveau ministère de centre gauche. Au terme d'un long débat, la loi qui introduit le divorce dans la législation italienne est adoptée par le Parlement. Aussitôt, de nombreuses organisations catholiques signent une demande de référendum pour l'abrogation de cette loi. La crise politique latente favorise les néofascistes, qui gagnent des voix aux élections partielles de juin 1971.
En décembre 1971, Leone est élu président de la République, mais derechef des difficultés apparaissent pour former un nouveau gouvernement. Le Parlement doit être dissous en février 1972 pour procéder à de nouvelles élections générales. Un nouveau gouvernement de coalition Andreotti est formé (juin 1972-juin 1973), auquel succède un gouvernement de centre gauche Rumor (juin 1973-mars 1974). Ce dernier, réformé en mars, doit affronter une série de scandales qui éclatent dans les milieux officiels.
En novembre, A. Moro forme un ministère à majorité démocrate-chrétienne ; mais, après le retrait du soutien du PSI, il est obligé de provoquer des élections anticipées en juin 1976. Celles-ci marquent une poussée sans précédent du PCI. Andreotti forme, en juillet, un ministère démocrate-chrétien minoritaire qui obtient l'investiture grâce à l'abstention des communistes.
2. Du compromis historique à l'opération « mains propres » (1976-1992)
2.1. L'échec du compromis historique et la vague terroriste (1976-1983)
Devant la recrudescence des violences, Andreotti parvient à réunir les représentants des 6 grands partis, des libéraux aux communistes. Cette réunion aboutit à un accord de compromis sur les grandes questions intérieures (4 juillet 1977), marquant la participation, pour la première fois depuis 30 ans, du PCI à l'élaboration d'un programme gouvernemental (politique dite de « solidarité nationale »). Le 22 juillet, les décrets d'application de la loi régionale sont adoptés. Un plan de stabilisation économique et une loi de reconversion industrielle sont mis au point.
Cependant, la violence politique, apparue au lendemain des grandes grèves de 1969, se poursuit ; des groupes armés révolutionnaires (Brigades rouges, Noyaux armés prolétariens) et les autonomes relaient le terrorisme fasciste, dont la vague s'est achevée en 1973. Le 16 mars 1978, le président de DC, Aldo Moro, est enlevé, puis assassiné le 19 mai, alors que les communistes rentrent dans la majorité gouvernementale lors d'un vote de confiance. Ce terrorisme d'extrême gauche a pour résultat d'empêcher la réalisation du compromis historique entre le PCI et la DC. Le 15 juin, à la suite d'une violente campagne de presse l'accusant de corruption, Leone doit démissionner et est remplacé à la présidence de la République par Alessandro Pertini (PSI).
Le gouvernement lance un nouveau plan triennal qui vise à la création de 500 000 emplois (le pays compte 1,6 million de chômeurs). En outre, l'Italie adhère au système monétaire européen (SME). Cette dernière décision ainsi que le refus de la DC d'admettre des ministres communistes amènent le PCI à retirer son soutien au gouvernement (janvier 1979).
L'interruption de l'expérience d'unité remet en cause la stratégie des trois grands partis. Cependant, les élections générales des 3-4 juin 1979 ne modifient pas profondément les équilibres, et la DC demeure la plus importante formation politique italienne. Le 4 août, Francesco Cossiga forme un gouvernement tripartite (DC, Démocratie libérale et PSDI). Mais la situation économique se détériore, tandis que le terrorisme fait de nombreux morts. En outre, le gouvernement doit affronter une nouvelle vague de revendications syndicales dans un climat lourd de défiance à la suite de la révélation de nombreux scandales touchant les milieux officiels. Le deuxième gouvernement Cossiga, formé en mars 1980, comprend des socialistes et prend des mesures de lutte contre le terrorisme. Il doit démissionner à la suite d'un vote défavorable de la Chambre sur des mesures économiques. Le président de la DC, Arnaldo Forlani, constitue un nouveau gouvernement grâce au soutien de l'ensemble des tendances de son parti. Après un nouvel attentat de l'extrême droite en août 1980, en gare de Bologne (85 morts), un tremblement de terre fait plus de 3 000 morts et quelques 300 000 sinistrés en Italie du Sud en novembre, provoquant une crise politique.
À la suite d'un nouveau scandale (plusieurs membres du cabinet sont accusés d'appartenir à une loge maçonnique P-2 qui serait impliquée dans des activités criminelles), Forlani présente sa démission et le leader des républicains, Giovanni Spadolini, forme un ministère en juin 1981 comprenant des démocrates-chrétiens, des socialistes, des sociaux-démocrates, des républicains et un libéral. Le nouveau gouvernement lutte contre le terrorisme et mène une politique d'austérité, mais les divergences entre les ministres socialistes et démocrates-chrétiens paralysent son action. G. Spadolini démissionne en novembre 1982 ; A. Fanfani forme un gouvernement, que la défection des socialistes contraint à démissionner dès avril 1983.
2.2. Les derniers gouvernements démocrates-chrétiens
Les élections anticipées de juin 1983 sont marquées par un net recul de la DC et par la progression du parti républicain (PRI) et de l'extrême droite. Bettino Craxi forme en juillet le premier gouvernement italien à direction socialiste, avec toutefois une majorité de ministres démocrates-chrétiens. Le gouvernement Craxi parvient, malgré l'opposition des communistes, à engager un certain nombre de réformes destinées à lutter contre l'inflation, notamment la suppression de l'échelle mobile des salaires. Mais si l'économie italienne connaît une certaine reprise, la balance commerciale continue à se dégrader, et la lire, à se déprécier. Depuis la signature, en février 1984, d'un nouveau concordat qui remplace les accords du Latran, le catholicisme n'est plus religion d'État.
En juillet 1985, Francesco Cossiga succède à Pertini à la présidence de la République. En avril 1987, après la démission du gouvernement Craxi (en mars), le démocrate-chrétien Fanfani est nommé président du Conseil, mais, à la suite d'un vote de défiance au gouvernement, des élections anticipées ont lieu en juin. Elles sont remportées par la DC, à qui échoit la présidence du Conseil, d'abord avec Giovanni Goria (1987-1988), ensuite avec Ciriaco De Mita (1988-1989), puis, au terme d'une nouvelle crise politique, avec Andreotti (1989-1992). En mai 1992, après la démission de Cossiga, un autre démocrate-chrétien, Oscar Luigi Scalfaro, accède à la présidence de la République.
2.3. La transformation du paysage politique et la crise de l'État (1988-1992)
Au début des années 1990, la scène politique italienne semble solidement contrôlée par la DC et le parti socialiste de Craxi. Mais trois facteurs vont bouleverser le paysage politique italien : l'effondrement du bloc soviétique, l'opération « mains propres » et le traité de Maastricht.
Achille Occhetto, élu secrétaire du PCI en juin 1988, décide de réformer le parti, qui devient le parti démocratique de la Gauche (PDS). Cette évolution se fait au prix de profonds déchirements internes et d'une scission de l'aile gauche, qui prend le nom de « Refondation communiste ». L'apparition sur la scène politique d'un nouveau parti, qui peut désormais légitimement faire valoir sa vocation gouvernementale, est un élément profondément perturbateur. Sans le ciment anticommuniste, les divergences profondes du monde catholique s'exacerbent et les raisons de son unité politique disparaissent. Quant au PSI, il ne peut plus revendiquer le statut de seul représentant d'une gauche démocratique.
Cette période est marquée par la crise de plus en plus profonde qui touche l'État italien. Des réformes institutionnelles s'imposent, mais les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les introduire. L'État se trouve également confronté au développement du crime organisé (à Naples, en Sicile et dans les Pouilles), qu'il ne parvient pas à enrayer. En mai et juillet 1992 sont assassinés à Palerme les juges anti-Mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Ces assassinats témoignent de l'impossibilité pour l'État de contrôler une partie du territoire national et du dysfonctionnement de l'administration publique. Dans les deux cas, la responsabilité est rejetée sur la « partitocratie », cette déviation de la démocratie par des partis politiques dont le pouvoir devient de plus en plus arrogant et incontrôlé.
Alors que les partis montrent toute leur impuissance, la magistrature occupe progressivement le devant de la scène politique. Le détonateur d'un mécontentement de plus en plus évident à l'égard des partis traditionnels est fourni par la mise au jour, à partir de février 1992, d'une corruption généralisée, érigée en véritable système de gouvernement. L'éclairage brutal de cette zone d'ombre dans la vie publique italienne et l'obstination des magistrats chargés de l'enquête « mains propres » à dénoncer tous les scandales provoquent un choc dans l'opinion publique, en faisant perdre toute légitimité à la classe dirigeante et au système politique.
L'Italie entre dans une phase de grande fragilité, dans laquelle les gouvernements se succèdent à un rythme rapide, tandis que beaucoup de dirigeants politiques et d'entrepreneurs sont accusés de corruption et emprisonnés. Parallèlement, la Ligue du Nord d'Umberto Bossi (qui développe le thème d'un fédéralisme radical frôlant l'indépendantisme) s'affirme en incarnant la révolte des secteurs les plus avancés de la société contre un pouvoir politique central inefficace et corrompu. Le système des partis axé sur l'hégémonie de la DC (le « pentapartito ») finit par disparaître pour laisser progressivement place à un système de plus en plus polarisé entre une droite et une gauche recomposées.
Le troisième facteur qui change le panorama politique italien est la signature, en 1992, du traité de Maastricht, sur la création de l'Union économique et monétaire (UEM) européenne, dont la troisième étape – la mise en place de l'euro – est prévue pour 1999. Au début des années 1990, la dette publique italienne dépasse désormais le PIB. Les gouvernements du socialiste Giuliano Amato (1992-1993) et de Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994), ex-gouverneur de la Banque d'Italie, poursuivent une politique de rigueur.
3. « Berlusconisme », bipolarisation et tentations séparatistes (1994-2011)
3.1. L'entrée en politique de Silvio Berlusconi
En mars 1994 se tiennent les premières élections législatives selon un mode de scrutin qui panache les systèmes proportionnel et majoritaire, approuvé par référendum en 1993. La loi électorale prévoit que 75 % des sièges seront pourvus sur la base d'un système de scrutin majoritaire à un seul tour, et 25 % selon le système proportionnel. L'homme d'affaires Silvio Berlusconi se présente devant le pays à la tête du mouvement de centre droit qu'il vient de créer, Forza Italia ; il s'allie avec des dissidents de l'ex-DC (qui a repris, en janvier 1994, le nom de parti populaire italien) et avec Alliance nationale (issue du MSI, néofasciste). Les résultats électoraux permettent à cette coalition de centre droit de former, avec l'aide de la Ligue du Nord, un gouvernement dirigé par Berlusconi. Mais, affaiblie par des dissensions internes, cette coalition doit céder la place, en janvier 1995, à un gouvernement de transition, composé de techniciens et dirigé par le libéral modéré Lamberto Dini. Celui-ci engage un programme de réformes avant d'être bientôt contraint de démissionner, faute de pouvoir s'appuyer sur une majorité suffisante.
3.2. La victoire du centre gauche
Les élections anticipées d'avril 1996 portent au pouvoir la coalition de centre gauche de L'Olivier, dirigée par le réformiste catholique Romano Prodi, qui devient président du Conseil. Disposant d'une majorité instable, le nouveau gouvernement a besoin des voix communistes du parti d'extrême gauche Refondation communiste. Malgré ce handicap et de nombreux obstacles, Prodi réussit à gouverner pendant plus de deux ans, avec pour objectif de permettre à l'Italie d'entrer dans l'UEM. Grâce à l'expérience de son ministre du Trésor, C. A. Ciampi, le gouvernement Prodi parvient à satisfaire à 4 des 5 critères de Maastricht en introduisant notamment, malgré les réticences de Refondation communiste, un impôt extraordinaire pour l'Europe. Le 5e critère est celui de la dette publique, qui, en dépit d'une légère réduction – suffisante pour convaincre la Commission européenne et les autres partenaires européens – représente encore environ 120 % du PIB. En octobre 1998, le gouvernement Prodi tombe après la décision d'une partie de Refondation communiste de ne pas appuyer le projet de loi de finances pour 1999.
Massimo D'Alema, dont le parti, Démocrates de gauche (DS), ex-PDS, jouit de la majorité relative, devient le premier président du Conseil ayant appartenu à l'ex-parti communiste. Cette coalition de centre gauche dépend à présent d'une formation centriste, l'Union démocratique pour la République (UDR), créée par l'ancien président de la République démocrate-chrétien Francesco Cossiga. À l'issue d'une crise politique, D'Alema, démissionnaire, forme un nouveau cabinet au sein duquel le parti récemment créé par Prodi, les Démocrates, fait son entrée, alors que la petite alliance centriste de Cossiga, à l'origine de la crise, passe dans l'opposition (décembre 1999). Cependant, l'échec des Démocrates de gauche aux élections régionales d'avril 2000 (au cours desquelles les présidents de région sont élus, pour la première fois, au suffrage universel direct) a raison du second gouvernement D'Alema. L'opposition, emmenée par Berlusconi, remporte 8 régions sur 15. Forza Italia confirme avec 25 % des suffrages sa position de premier parti politique italien (il avait retrouvé sa place de leader lors des élections européennes de juin 1999).
En dix-huit mois d'exercice du pouvoir, D'Alema a démontré que l'Italie était non seulement un allié fiable – en participant directement aux frappes aériennes de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie (mars-juin 1999) puis en engageant ses troupes dans la Kfor –, mais qu'elle était aussi un partenaire solide pour ses voisins européens, en poursuivant l'œuvre d'assainissement de son économie, depuis son entrée dans la zone euro. La nomination de l'ex-président du Conseil, Prodi, à la présidence de la Commission européenne souligne l'importance que revêt désormais la place de l'Italie au sein de l'Union européenne et du rôle grandissant qu'elle est appelée à y jouer. D'Alema n'est pas parvenu à associer l'opposition à l'ambitieuse réforme institutionnelle lancée en 1998, qui doit octroyer des pouvoirs accrus aux régions et doter à terme l'Italie d'une structure fédérative.
En mai 1999, O. L. Scalfaro est remplacé à la présidence de la République par Carlo Azeglio Ciampi, élu dès le premier tour.
3.3. Vers une bipolarisation de la vie politique
Un gouvernement de centre gauche est constitué en mai 2000 par Amato, déjà président du Conseil en 1992-1993. Mais, cette fragile coalition doit aussitôt faire face aux attaques répétées de l'opposition, qui réclame des élections anticipées. Ainsi, quelques semaines après son arrivée au pouvoir, Amato est affaibli par l'échec du scrutin référendaire (annulé pour cause de participation insuffisante), qui devait entériner divers projets de réforme, dont le changement de loi électorale.
Bénéficiant du retour de la croissance et d'une embellie économique, le président du Conseil ramasse les dividendes de cinq années d'austérité et de rigueur budgétaire, imposées par la majorité de centre gauche et peut proposer une loi de finances pour 2001 plus attrayante que les précédentes (réduction d'impôts, mesures de relance de la consommation et créations d'emplois). Mais, divisé et incapable de se renouveler, le centre gauche assiste avec impuissance au retour de Berlusconi et de son Pôle des libertés. En prévision des législatives de 2001, la majorité au pouvoir préfère Francesco Rutelli, le maire de Rome, à Amato, pour tenter de contrer le retour annoncé de Berlusconi.
Ce dernier a entamé sa reconquête du pouvoir dès le milieu des années 1990, après son premier et bref passage à la tête du gouvernement (avril-décembre 1994), conclu par une sortie peu glorieuse sous la pression des enquêtes judiciaires. Pendant quatre années, le magnat de la communication s'est employé à transformer son mouvement Forza Italia en un véritable parti. Désormais chef de file de l'opposition, il Cavaliere (nom donné au chevalier de l'ordre du Travail) constitue, au sein du Pôle des libertés (devenu en 2000, la Maison des libertés), une alliance regroupant, outre Forza Italia, l'Alliance nationale de G. Fini, mais également la Ligue du Nord d'Umberto Bossi, élément très controversé en raison de ses positions xénophobes et sécessionnistes. Bien que U. Bossi soit responsable de la chute de son gouvernement en décembre 1994, Berlusconi a signé avec ce partenaire – indocile mais nécessaire – un accord sur l'immigration et la dévolution de pouvoirs aux régions.
La Maison des libertés remporte les élections législatives de mai 2001, s'assurant la majorité absolue tant à la Chambre des députés (368 sièges sur 630) qu'au Sénat (177 sur 315). Toutefois, en nombre de voix, sa victoire est courte sur le centre gauche qui, affaibli par ses divisions (Refondation communiste reste en dehors de L'Olivier, mené par Rutelli) et ses querelles internes, n'est pas parvenu à convaincre. Ces élections font apparaître une bipolarisation de la scène politique italienne, les grands partis se consolidant au sein des deux coalitions, au détriment des petits partis charnières, dont le pouvoir de faire ou de défaire les majorités commence à faiblir.
3.4. Le second gouvernement Berlusconi (2001-2005)
Formé en juin 2001 après de longues tractations, le gouvernement Berlusconi est, à l'image de sa coalition, l'un des plus à droite que la péninsule ait connus depuis l'avènement de la République en 1946. Gianfranco Fini (Alliance nationale) est nommé vice-président du Conseil, U. Bossi (Ligue du Nord) devient ministre des Réformes et de la Décentralisation. Seule la nomination au sein de ce gouvernement majoritairement eurosceptique de Renato Ruggiero, européen convaincu, aux Affaires étrangères, rassure la communauté internationale. Sous la houlette du Cavaliere, qui s'engage à « changer l'Italie », le gouvernement s'emploie avec zèle à élaborer une série de mesures, essentiellement destinées à servir les intérêts privés de Berlusconi et de ses proches : ainsi, dès 2001, sont adoptées les lois sur la garantie d'immunité aux capitaux transférés illégalement, l'abrogation de la taxe sur la succession des grandes fortunes, la dépénalisation de la plupart des crimes de falsification de bilan, la limitation de l'entraide judiciaire internationale ou le recours pour « suspicion légitime » envers les juges. Largement controversées, ces lois poussent dans la rue en septembre 2002 les girotondi (rondes citoyennes) qui dénoncent le « gouvernement de l'illégalité ». Adoptée en juillet 2002, la loi Bossi-Fini durcit les conditions d'entrée et de séjour des immigrés, facilite l'expulsion des clandestins et, paradoxalement, permet la régularisation de plus de 700 000 sans papiers. Votée en février 2003, la loi Biagi sur la réforme du droit de licenciement (du nom du professeur Marco Biagi à l'origine du texte et assassiné par les Brigades rouges le 19 mars 2002) irrite les syndicats et l'opposition qui estiment qu'elle entraîne une forte précarité chez les jeunes ; mieux accueillie par le patronat, elle déçoit néanmoins ce dernier, qui ne voit arriver aucune des réformes libérales annoncées lors de la campagne électorale. Enfin, la majorité de Berlusconi fait adopter la loi visant à redéfinir l'ensemble de l'audiovisuel italien : en élevant le plafond des concentrations autorisées, la loi Gasparri permet à Mediaset (l'empire médiatique du Cavaliere) de conserver ses 3 chaînes hertziennes (Canale 5, Italia 1 et Rete 4), alors qu'une décision de la Cour constitutionnelle l'oblige à se débarrasser de l'une d'elles avant le 31 décembre 2003. Après un premier renvoi de la part du président de la République, C. A. Ciampi, en décembre 2003, la loi sur l'audiovisuel est finalement votée en mai 2004. De la même manière, la Cour constitutionnelle invalide en janvier 2004 un projet de loi garantissant aux cinq plus hauts responsables de l'État l'immunité pendant la durée de leur mandat et, à la fin de l'année, le chef de l'État refuse de promulguer la réforme de la magistrature.
Sur le plan international, l'arrivée au pouvoir de Berlusconi se traduit par un virage eurosceptique, perceptible dans des déclarations idéologiques (sortie anticommuniste au sommet de Göteborg de juin 2001), ou manifeste lors de prises de position à contre-courant (rejet de l'avion de transport militaire européen, opposition durable à la création d'un mandat d'arrêt européen) entraînant dès 2002 la démission du ministre des Affaires étrangères Ruggiero et suscitant le trouble parmi ses partenaires de l'Union européenne, dont l'Italie assure la présidence au cours du premier semestre 2003. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Italie, à l'instar de toute l'Union, se place aux côtés des États-Unis, mais, alors que George W. Bush tente de rallier les pays arabes modérés, le président du Conseil vante la « supériorité » de la civilisation occidentale sur l'islam devant la presse à Berlin. Au moment de l'intervention américano-britannique contre l'Iraq, il est davantage du côté de Washington que de Paris, Berlin ou Moscou, sans pour autant s'aligner pleinement sur G. W. Bush, José María Aznar ou Tony Blair, en raison de l'ampleur des manifestations pacifistes dans son pays et des pressions exercées par le Vatican.
3.5. Le renforcement de la gauche et le troisième gouvernement Berlusconi (2004-2006)
D'incessantes polémiques agitent la coalition gouvernementale et paralysent son action. Tiraillée entre les exigences contradictoires de ses partenaires – notamment sur le projet de fédéralisme soutenu par la Ligue du Nord mais contesté par l'Alliance nationale et les centristes de l'Union des démocrates-chrétiens et du Centre (UDC, issue en février 2002 de la fusion du Centre chrétien démocrate, des Chrétiens-démocrates unis [CDU] et de Democrazia Europea) –, la majorité de Berlusconi échoue ou tarde à faire adopter les réformes promises : ainsi la réforme de la fiscalité se réduit à une baisse des impôts de 6,5 milliards d'euros pour 2005 arrachée au prix d'infinies tractations qui ont mis en péril la coalition ; l'application de la réforme du régime des retraites, vivement contestée, est différée à 2008. Les dissensions finissent par éclater en une crise ouverte en juillet 2004 avec le limogeage du ministre de l'Économie et des Finances et le départ de U. Bossi pour le Parlement européen. Après avoir essuyé une série de revers électoraux aux élections locales partielles de mai-juin 2003 puis aux élections européennes et locales de juin 2004, la coalition enregistre une cuisante défaite lors des régionales partielles d'avril 2005 : sur 13 régions soumises à un renouvellement, elle n'en conserve que 2 (Lombardie et Vénétie), le centre gauche en détenant désormais 16 sur un total de 20. Cette déroute entraîne la plus grave crise de la coalition : reprochant son immobilisme au Cavaliere, l'UDC puis le petit parti socialiste italien (autre composante de la coalition) en retirent, l'une ses 4 ministres, l'autre ses 2 représentants. Poussé à la démission (avril 2005), Berlusconi forme un nouveau gouvernement au sein duquel Forza Italia se voit renforcé. Toutefois, l'avenir du gouvernement-bis à peine formé est obscurci par une crise économique qui frappe durement l'Italie et qui constitue l'échec majeur de celui qui se voulait le « PDG de l'entreprise Italie ».
Dans la perspective des élections législatives des 9 et 10 avril 2006, Berlusconi s'autoproclame candidat unique du centre droit à sa propre succession dès juillet 2005. En décembre, il fait modifier la loi électorale – qui revient au scrutin proportionnel avec une prime accordant la majorité absolue de sièges à la coalition gagnante – et conclut, à deux mois de l'échéance, une alliance électorale avec le mouvement Alternative sociale, fondé en 2004 par la petite-fille du Duce, Alessandra Mussolini. Tout au long de sa campagne électorale, comme durant son mandat, il Cavaliere n'a de cesse d'attiser les divisions au sein de la société italienne, jouant sur les peurs multiples (précarité, délinquance, immigration, augmentation de la fiscalité) de ses concitoyens et réactivant la méfiance envers la gauche.
3.6. L'éphémère expérience du second gouvernement Prodi (2006-2008)
Évitant la déroute que lui prédisaient les sondages, sa coalition de centre droit, la Maison des Libertés, parvient au seuil de la victoire, qui lui échappe de justesse : avec 24 755 voix d'avance (soit 49,8 % contre 49,7 %), l'Union, la coalition de centre gauche rassemblée autour de L'Olivier et emmenée par Romano Prodi, obtient la prime prévue pour la coalition gagnante et dispose d'une confortable majorité à la Chambre des députés (340 sièges sur 630). Au Sénat en revanche, elle ne dispose que de 158 sièges contre 156 pour la Maison des Libertés.
Conforté par les résultats de Forza Italia, qui demeure le premier parti italien, Berlusconi refuse dans un premier temps de reconnaître sa défaite et exige un nouveau décompte des voix. Le 19 avril, la Cour de cassation confirme la victoire – aussi étroite soit-elle – de l'Union mais il Cavaliere envisage d'autres recours. Ce n'est qu'après l'élection le 29 avril de l'ancien leader syndical Franco Marini à la présidence du Sénat et celle du communiste Fausto Bertinotti à la présidence de la Chambre des députés, permettant l'installation de la nouvelle coalition de centre gauche dirigée par Prodi, que le président du Conseil sortant remet sa démission.
Après le renoncement du président C. A. Ciampi à solliciter un nouveau mandat, le sénateur de centre gauche Giorgio Napolitano est élu, le 10 mai, à la présidence de la République.
L'Union, rassemblée autour de L'Olivier de Prodi, est une coalition de 9 partis, hétéroclite et divisée, uniquement liée par la volonté d'empêcher le retour de Berlusconi. Ne disposant que d'une très étroite majorité (notamment au Sénat), elle progresse aux élections municipales partielles des 28 et 29 mai 2006 : Walter Veltroni (Démocrates de gauche) est plébiscité à Rome ; à Turin et à Naples, les maires sortants de centre gauche conservent leur siège dès le premier tour. Plus tard, les 25 et 26 juin, la coalition de Prodi sort confortée par le « non » (61,7 %) des Italiens à une refonte en profondeur de la Constitution (qui devait accorder davantage de pouvoir au président du Conseil et renforcer l'autonomie des régions) demandée par Berlusconi et la Ligue du Nord. Elle parvient à maintenir une politique budgétaire de rigueur qui satisfait aux critères européens du pacte de stabilité, à mettre en œuvre plusieurs réformes libérales et à créer, malgré l'opposition du Vatican et des centristes, les « dico » (droits et devoirs des personnes vivant ensemble).
Sur le plan extérieur, Prodi affirme vouloir replacer l'Italie au centre de l'Europe.
Conformément à ses promesses, il rapatrie les troupes italiennes envoyées en Iraq (décembre), mais, en contrepartie, décide le maintien du contingent italien en Afghanistan et l'agrandissement de la base américaine de Vicence. Cette concession faite aux États-Unis lui vaut d'être mis en minorité au Sénat par la gauche de sa coalition (communistes et Verts) : le président du Conseil remet la démission de son gouvernement (21 février 2007) avant d'être reconduit une semaine plus tard à la tête de la même coalition « ressoudée », à laquelle il impose un programme en douze points « non négociables ».
Mais le sursis accordé par Prodi est de courte durée. N'ayant pas obtenu la solidarité du gouvernement à son égard, le ministre de la Justice, mis en cause dans une affaire de corruption, démissionne en janvier 2008, entraînant avec lui la défection de son parti, l'Union des démocrates pour l'Europe (Udeur), allié chrétien-démocrate de la coalition au pouvoir, décisif au Sénat pour la majorité de centre gauche. Afin de clarifier la situation politique du pays et de mettre ses alliés devant leurs responsabilités, le président du Conseil décide de se présenter devant le Parlement. S'il obtient la confiance des députés par 326 voix contre 275 (et l'abstention de l'Udeur), il est mis en minorité au Sénat sur la déclaration de politique étrangère par 161 voix contre et 156 en sa faveur, entraînant finalement la dissolution des chambres et l'organisation d'élections législatives anticipées.
3.7. La transformation de la gauche et le retour au pouvoir de Berlusconi (2008)
À l'automne 2007, tandis que le gouvernement Prodi tente de sauver sa fragile coalition, on assiste à une recomposition des forces politiques.
Au centre gauche, sous la direction de Veltroni, le maire de Rome, à la suite de la fusion des Démocrates de gauche (DS) et de La Marguerite (issue en 2002 de L'Olivier autour de Rutelli) naît le parti démocrate (PD), tandis qu'au centre droit, Berlusconi annonce la création du Peuple de la Liberté (PDL), issu du regroupement de son mouvement Forza Italia, d'Alliance nationale, et de divers groupes démocrates-chrétiens, libéraux et centristes, ces forces étant destinées également à se fondre dans un nouveau parti. Enfin, Refondation communiste, les Verts, le parti des Communistes italiens et la Gauche démocratique s'allient de leur côté dans La Gauche-L'Arc-en-ciel.
Malgré la rapidité de ces réalignements, les élections des 13 et 14 avril 2008 sont marquées d'emblée par une simplification des clivages politiques. Le PD veut désormais se passer de l'alliance avec la gauche communiste et les écologistes pour se présenter comme la seule alternative crédible à Berlusconi. Ce dernier s'affirme, de son côté, comme le leader apparemment incontesté d'une droite « décomplexée », même s'il doit toujours compter sur son alliance avec la Ligue du Nord, qui conserve son autonomie.
Au terme d'une campagne électorale sans éclat mais apaisée, Berlusconi et le Peuple de la Liberté l'emportent largement avec 37,3 % des voix (276 sièges à la Chambre des députés et 147 au Sénat) devant Veltroni et le PD qui en recueillent 33,1 % (217 députés et 118 sénateurs). Cette victoire sans appel est amplifiée à l'issue du second tour des élections municipales et provinciales partielles des 27 et 28 avril, avec, en particulier, l'élection retentissante à la mairie de Rome de Gianni Alemanno – candidat du Peuple de la Liberté, ancien activiste du MSI et membre de l'Alliance nationale – qui remporte 53,6 % des voix face à Rutelli.
Issu du parti communiste, Veltroni a résolument opté pour un recentrage de la gauche italienne, à l'instar de la plupart des socialistes européens, et pour la rupture avec ses alliés d'hier, mais il n'a probablement pas eu le temps nécessaire pour convaincre. L'appel au « vote utile » a été en partie entendu : des petits partis (non régionalistes), seule la liste « Italie des valeurs » conduite par Antonio Di Pietro (l'ex-juge à l'origine de l'opération « mains propres »), alliée au PD, se maintient au Parlement en obtenant, avec 4,3 % des voix, 29 députés et 14 sénateurs.
La nouveauté de ce scrutin réside ainsi dans la disparition – à la suite de ralliements ou faute d'alliance – des petits partis de gauche et dans l'échec de la coalition Arc-en-ciel. Cependant, le PD et la liste Di Pietro n'ont attiré qu'une partie de ces voix qui se sont, soit perdues dans l'abstention ou à l'extrême gauche, soit même reportées sur la Ligue du Nord. Cette dernière apparaît, dans une certaine mesure, comme le grand gagnant des élections puisqu'elle recueille 8,3 % des voix (60 sièges à la Chambre et 25 au Sénat), tandis que l'Union du Centre (UDC) de Pier Ferdinando Casini, désormais opposée à Berlusconi mais aussi à sa dissolution dans le PD, réussit à faire élire, avec 5,6 % des voix, 36 députés et 3 sénateurs.
Hormis ces deux mouvances, l'évolution du système politique italien confirme sa bipolarisation. Toutefois, dans cette lente transition vers une « IIe République » tant attendue, des questions essentielles demeurent irrésolues. Les deux camps, qui ont désormais l'ambition de se restructurer autour de deux grands partis, doivent concilier des traditions politiques et idéologiques divergentes, voire opposées – catholiques et laïques, centralisatrices et régionalistes, libérales et nationalistes. Obligation leur est faite, pour rendre cette mutation pérenne, d'imposer une discipline interne sans laquelle les factions et les querelles intestines ne peuvent que se redéployer comme semble le confirmer l'évolution politique en 2008 et 2009.
3.8. Berlusconi contre vents et marées (2008-2009)
Dans les mois qui suivent sa formation, prônant une accélération et une simplification du travail législatif recourant largement à cet effet au décret-loi, le quatrième gouvernement Berlusconi prend un certain nombre de mesures d'urgence. Parmi les domaines prioritaires figurent en bonne place la sécurité publique et le contrôle de l'immigration tandis qu'au plan économique, les restrictions budgétaires s'accompagnent d'une « rationalisation » de l'administration publique (avec l'introduction de primes de productivité notamment) et d'allègements fiscaux en faveur des ménages. La réforme scolaire et universitaire vise également une réduction des dépenses et une augmentation de la « productivité » de l'enseignement mais provoque la première grande manifestation des forces de centre gauche en octobre 2008 et son application suscite de fortes résistances. Confronté à la crise financière et économique internationale, le gouvernement doit pourtant réévaluer ses dépenses à la hausse, creusant davantage le déficit budgétaire et aggravant la dette publique (plus de 105 % du PIB, la plus importante au sein de l'UE).
La médiatisation de certaines mesures – comme la mobilisation de l'armée pour résoudre la « crise des déchets » à Naples ou le relogement d'une partie des victimes du séisme à L'Aquila – contribuent à la popularité de l'« inoxydable » président du Conseil, toujours très élevée malgré les conflits d'intérêts, les déclarations intempestives à l'humour douteux ou les affres de sa vie privée qui embarrassent ses homologues à l'étranger mais laissent indifférents les Italiens dans leur grande majorité.
Face à ce champion de la politique-spectacle et au Peuple de la Liberté – qui fusionne en mars 2009 avec l'Alliance nationale du président de la Chambre Gianfranco Fini – l'opposition de centre gauche ne parvient toujours pas à se relever de sa défaite d'avril 2008 et de ses divisions. Après de nouveaux revers électoraux au niveau régional, dont un échec cinglant en Sardaigne, Veltroni démissionne de la direction d'un parti démocrate (PD) qui, déjà en proie aux rivalités internes, parvient à résister vaille que vaille dans ses fiefs traditionnels d'Italie centrale aux élections municipales et provinciales de juin. Toutefois, ce scrutin se caractérise davantage par un rééquilibrage en faveur de la droite que par le triomphe du PDL. Au sein de ce mouvement encore peu structuré, Gianfranco Fini montre son indépendance – prenant notamment ses distances avec les mesures les plus répressives à l'encontre des immigrés ou rappelant son allié au strict respect de la laïcité – tandis que sur sa droite, la Ligue du Nord, allié puissant mais encombrant, ne cesse d'exercer sa pression avec son programme fédéraliste et de plus en plus xénophobe. Par ailleurs, les deux autres partis charnière, l'UDC et Italie des valeurs, se maintiennent et recueillent même les voix des déçus des deux camps.
L'image de Silvio Berlusconi semble aussi se ternir auprès de son électorat le plus conservateur et les relations avec l'Église catholique se tendent ; un mécontentement sourd qui s'exprime dans l'abstention, plutôt défavorable au PDL. Enfin, en octobre 2009, l'invalidation par le Conseil constitutionnel de son immunité pénale (votée en juillet 2008) afin de mettre à l'abri le Cavaliere pendant la durée de son mandat des poursuites judiciaires alors en cours, est désapprouvée par l'opinion publique. Mais, pour déjouer un hypothétique déclin et dans l'attente des élections régionales de 2010 – prochain test électoral –, le président du Conseil use de ses armes favorites et compte sur d'indéniables atouts : outre ses sempiternelles attaques contre la magistrature et la presse d'opposition ou ses appels au peuple contre les « comploteurs » et les « fossoyeurs » de l'Italie, il peut probablement miser encore sur la prégnance culturelle du « berlusconisme ».
3.9. L'ascension de la Ligue du Nord et les fractures de la droite (2010)
Les 28 et 29 mars 2010, à l’issue des élections dans 13 des 20 régions du pays – marquées par une assez forte abstention (35,8 % contre 28 % en 2005) – la Ligue du Nord de Umberto Bossi, alliée au PDL sur des listes communes, fait une percée sans précédent en Vénétie – plus de 35 % contre 14,7 % en 2005 et où son candidat est élu président avec 60,1 % des voix –, en Lombardie – 26,2 % contre 15,8 % – et au Piémont, ravi au centre gauche, où elle double son audience avec 16,7 % des suffrages et dont elle obtient également la présidence. S’implantant dans des provinces piémontaises comme celles de Vercelli ou de Cuneo avec 25 % des voix, elle dépasse 30 % dans plusieurs provinces lombardes comme celles de Brescia ou de Sondrio (42 %) et établit un record dans la province de Trévise (Vénétie) avec 48,5 %. De plus, son audience augmente même dans un bastion du parti démocrate (PD) comme l’Émilie-Romagne, en passant de 4,8 % à 13,6 % des voix.
À l'échelle nationale, l'écart global entre le centre gauche et le centre droit se resserre pourtant avec près de 45 % des suffrages pour le premier contre 42 % aux élections législatives de 2008 tandis que PD et PDL restent au coude à coude avec environ 26 % des voix chacun. Conservant 7 régions sur les 13 en lice, la gauche perd cependant également le Latium où Emma Bonino (48 %) doit s’incliner face à Renata Polverini (51 %), secrétaire générale du syndicat « autonome » UGL.
Complètement remis de l’agression dont il avait été victime en décembre, S. Berlusconi peut ainsi être satisfait d’un résultat qui profite globalement au Peuple de la Liberté mais doit tenir compte davantage des revendications de son allié fédéraliste. D’autant que les relations orageuses avec son autre allié G. F. Fini conduisent finalement, en juillet 2010, à l’éclatement du PDL et à la création par le président de la Chambre d’un nouveau mouvement autonome, hors de la majorité, baptisé « Futur et liberté pour l’Italie » (FLI), dont les 4 représentants au gouvernement démissionnent. Mais ses 36 députés hésitent à passer dans l’opposition et S. Berlusconi échappe d’extrême justesse – à 3 voix près – à un vote de défiance le 14 décembre. Tandis que l’idée d’une « troisième force » fait son apparition, le projet de recomposition de la droite italienne a ainsi fait long feu ; de surcroît, le gouvernement du Cavaliere est désormais très fragilisé.
3.10. Les revers électoraux du berlusconisme (2011)
Alors que S. Berlusconi doit de nouveau affronter la justice (pour une affaire de mœurs baptisée le « Rubygate »), les élections municipales et provinciales partielles de mai 2011 – concernant environ 13 millions d’électeurs, plus de 1 000 communes et 11 provinces – constituent un sérieux revers pour le président du Conseil, tout particulièrement dans son fief de Milan, dont la mairie est ravie au Peuple de la Liberté par le candidat de la coalition de centre gauche, Giuliano Pisapia. De plus, le PDL recule fortement dans la plupart des autres chefs-lieux de province du Nord : Ravenne, Rimini, Bologne, Trieste, Pordenone, Savone, Varese, Turin, Rovigo. De son côté, la Ligue du Nord y réalise des scores supérieurs à ceux des municipales passées mais inférieurs à ses résultats régionaux de 2010 et perd plusieurs communes. Quant au centre gauche, il parvient notamment à arracher à la droite, outre Milan et d’autres villes de Lombardie, Trieste, Novare, Cagliari, les provinces de Pavie et de Macerata, tandis qu’il conserve Naples – dont la mairie revient au candidat d’« Italie des valeurs » –, Turin, Bologne ou Grosseto.
En juin, le Premier ministre est également désavoué à l’occasion de quatre référendums abrogatifs d’initiative populaire qui atteignent tous le quorum nécessaire pour être validés : près de 55 % des inscrits se rendent ainsi aux urnes – une mobilisation sans précédent pour une consultation de cette nature depuis 1995 – et rejettent massivement (plus de 90 %) plusieurs textes législatifs sur la privatisation et le tarif de l’eau, la construction de centrales nucléaires et le « légitime empêchement » permettant aux ministres de ne pas comparaître devant la justice. Reconnaissant la défaite mais rejetant avec son assurance habituelle les appels à sa démission en provenance de l’opposition, le Cavaliere semble désormais fortement déstabilisé.
4. L'Italie à l'épreuve de la crise économique (2011-2018)
4.1. La démission de Berlusconi
Prise à son tour – après la Grèce – dans la tourmente de la crise des dettes souveraines, l’Italie, quatrième puissance économique de l’UE dont l’endettement atteint cependant 120 % du PIB – mais dont le déficit budgétaire reste inférieur à la moyenne européenne – est placée sous la pression des marchés à la suite de son déclassement par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s, suivi d’une envolée des taux obligataires italiens.
Face à cette défiance croissante quant à la solvabilité et la gouvernabilité du pays, Silvio Berlusconi, sommé par ses partenaires européens de faire adopter de nouvelles mesures d’austérité et de relance et ne pouvant désormais plus compter sur une majorité absolue au parlement, se résigne à démissionner le 12 novembre. Peu avant, les deux chambres ont adopté une loi de stabilité financière promise à l’UE.
4.2. Un gouvernement « technique » d'urgence
Nommé président du Conseil, l’économiste Mario Monti, ancien commissaire européen au Marché intérieur puis à la Concurrence (1994-2004), forme dès le 16 novembre un gouvernement resserré, composé exclusivement d’experts dans leurs responsabilités ministérielles respectives, et dans lequel, le Premier ministre prend jusqu'en juillet 2012 le portefeuille de l’Économie et des Finances. Un nouveau ministère du Développement économique, des Infrastructures et Transports, confié au banquier Corrado Passera, est créé tandis que le ministère du Fédéralisme est remplacé par celui de la Cohésion territoriale. À l’exception des représentants de la Ligue du Nord, hostile au programme de rigueur et accusant Mario Monti et ses collaborateurs d’incarner le pouvoir des banques, les sénateurs puis les députés accordent massivement leur confiance au nouveau gouvernement.
Dès le mois de décembre, un premier train de mesures d’urgence est adopté : baptisé « Salva Italia » (« Sauve l’Italie »), le programme a pour ambition de rétablir un quasi-équilibre des finances publiques dès 2013. Réparti entre baisse des dépenses, augmentation des recettes et appui à la croissance, il inclut notamment la suppression des conseils provinciaux et la baisse des fonds pour les régions et les communes, l’augmentation ou la modification de certains impôts dont une hausse de la TVA et la création d’une nouvelle taxe foncière, un allègement des charges fiscales et sociales sur les entreprises, un durcissement de la lutte contre l’évasion fiscale.
L’un des fers de lance du programme est l’accélération de la réforme de la prévoyance sociale avec le passage général de l’âge de la retraite à 66 ans vers 2018 (dès 2012 dans la fonction publique), une augmentation des années de cotisation et une révision du mode de calcul des pensions. Ce premier décret-loi est suivi d’autres mesures structurelles destinées à appuyer la croissance à court et plus long terme – décret-loi « Cresci Italia » (« Grandis Italie ») en janvier 2012, décret-loi « Développement » du mois d’août – ou à améliorer l’efficacité de l’administration publique et à simplifier les démarches administratives (« Semplifica Italia », février-avril). L’objectif est notamment de lever les obstacles bureaucratiques à la création d’entreprises, d’encourager la concurrence dans le secteur des transports, de faciliter l’investissement dans celui des travaux publics, d’appuyer le développement des Technologies de l’information et de la communication… Une réforme du marché du travail est également adoptée par le Parlement en juin avec le triple objectif d’augmenter la compétitivité des entreprises, d’intégrer les jeunes et les femmes et d’assouplir les conditions de licenciement. Un accord sur la productivité entre syndicats (à l’exception de la CGIL) et patronat est aussi conclu au mois de novembre.
La récession atteint - 2,8 % en 2012 et s’accompagne d’un taux de chômage de plus de 10 % (autour de 35 % chez les jeunes), mais cette politique, qui ne peut produire ses effets qu’à moyen et long terme, est accueillie avec satisfaction par des observateurs comme l’OCDE, par le FMI, ainsi que par les créanciers de l’Italie, qui regagne une crédibilité perdue un an plus tôt.
Au plan intérieur, la politique menée est acceptée – avec résignation pour certains –, par une grande partie des Italiens et reçoit l’appui des partis politiques majoritaires. Ces derniers sont en pleine restructuration : alors qu’un nouveau mouvement populiste, le Mouvement Cinq étoiles (M5S) mené par le comique Beppe Grillo, a fait irruption dans la vie politique, au centre droit, le PDL et la Ligue du Nord doivent tirer les leçons de leur défaite aux élections municipales partielles de mai ; au centre gauche, le parti démocrate de Pier Luigi Bersani est en quête d’une nouvelle stratégie dans la perspective des élections législatives de 2013 pour lesquelles il est donné gagnant. Le retour sur la scène politique de Berlusconi et la décision du PDL de retirer son soutien au gouvernement entraînent finalement la démission de Mario Monti, qui décide de s’engager dans la bataille électorale à la tête d’une coalition de petits partis centristes, catholiques et libéraux. Son gouvernement continue d’expédier les affaires courantes dans l’attente du scrutin.
4.3. Un bouffon dans l'arène
Les élections anticipées de février 2013 se soldent par le succès retentissant du M5S de Beppe Grillo qui, avec 25,55 % des suffrages (pour la Chambre), devance le PD (25,42 %) et le PDL (21,56 %). Ce bateleur plein de faconde, qui a fait campagne dans des meetings publics et sur Internet mais en dehors des médias qu’il fustige, réussit son pari d’ébranler l’ensemble de l’establishment politique en faisant élire 108 députés et 54 sénateurs, néophytes pour la plupart d’entre eux. Axant son discours sur un rejet de la « partitocratie » et de ses compromissions, mais aussi de l’UE, de ses « diktats » et des mesures d’austérité, prônant une démocratie citoyenne participative, son mouvement parvient à capter des voix en provenance de la gauche et de l’extrême gauche ainsi que de la droite comme en témoigne, par exemple, son score en Vénétie (entre 25 % et 27 %) alors que la Ligue du Nord y est réduite à 10 % des suffrages. Sa percée est d’autant plus spectaculaire qu’elle s’observe sur l’ensemble du territoire national : le M5S vient ainsi en tête en Sicile en y obtenant de 32 % à 34 % des voix tandis qu’il en rassemble 25 % en Toscane et en Émilie Romagne majoritairement acquises à la coalition de centre gauche menée par Pier Luigi Bersani. Arrivée en tête du scrutin avec environ 30 % des votes, cette dernière obtient une majorité de sièges à la Chambre en vertu de la prime au vainqueur mais reste minoritaire au Sénat.
L’autre surprise de ce scrutin historique est en effet la résistance notable du PDL et de Silvio Berlusconi qui, malgré les diverses procédures judiciaires engagées contre lui, refait surface, s’affichant comme la victime d’une persécution politique. La coalition de centre droit – pour l’essentiel PDL et Ligue du Nord – obtient ainsi également autour de 30 % des suffrages fondant sa légitimité sur son opposition de dernière minute à la politique menée par Mario Monti. Celui-ci est le grand perdant du scrutin en ne parvenant à réunir sur son nom qu’environ 9 % des voix. Alors que sa politique n’avait pas mobilisé dans la rue d’oppositions comparables, par exemple, au mouvement espagnol des « indignés », ces élections prennent l’allure d’une « insurrection électorale ».
4.4. Paralysie politique avant un compromis inédit
Dans cette situation de blocage où les trois grandes forces politiques se neutralisent mutuellement, les discussions pour former une coalition s’avèrent infructueuses et une majorité claire ne peut être dégagée. Chargé de former le gouvernement, Pier Luigi Bersani se heurte notamment à l’intransigeance du M5S et finit par renoncer puis par démissionner de la direction du PD, alors que ce dernier se déchire à l’occasion de l’élection par les grands électeurs du président de la République dont le mandat est arrivé à son terme.
Faute d’une majorité pour les différents candidats, ce n’est qu’au sixième tour de scrutin que le président sortant Giorgio Napolitano, seule personnalité consensuelle, accepte de se représenter pour tenter de sortir le pays de la crise institutionnelle et reçoit un large soutien avec 738 voix sur 1007. Enrico Letta, numéro 2 du PD et issu de la gauche démocrate-chrétienne, parvient alors à former un gouvernement de coalition inédit avec comme partenaire principal le PDL – qui obtient notamment le poste de vice-Premier ministre/ministre de l’Intérieur – mais comprenant également plusieurs personnalités indépendantes.
Les 29-30 avril, après un discours programmatique proeuropéen mais critique à l’égard des politiques unilatérales de rigueur, le nouveau président du Conseil obtient la confiance des deux chambres et parvient à surmonter la menace d’une crise gouvernementale provoquée par S. Berlusconi en conservant une majorité à la suite de la scission du PDL en novembre et de la création du Nouveau Centre-droit (NCD).
Il est cependant évincé par Matteo Renzi, secrétaire national du parti démocrate depuis décembre, qui parvient à le remplacer en février 2014 avec l’appui de la direction du parti. Un gouvernement de coalition similaire au précédent et qui pourrait bénéficier du soutien extérieur, au cas par cas, de Forza Italia (ex-PDL), est alors formé. Angelino Alfano, fondateur et dirigeant du NCD, principal partenaire du PD, conserve son portefeuille de l’Intérieur tandis que Pier Carlo Padoan, économiste en chef de l’OCDE, prend la tête du ministère de l’Économie et des Finances. Après la présentation d’un programme comprenant notamment des réformes institutionnelles et fiscales, le nouveau président du Conseil obtient la confiance du Sénat et de la Chambre des députés le 25 février.
4.5. Matteo Renzi et les réformes
La flexibilisation du marché du travail, la diminution de la pression fiscale et la réduction de la dépense publique sont les principaux axes de la politique économique et sociale du nouveau gouvernement. Prenant de court les syndicats, au premier rang desquels la CGIL, M. Renzi obtient l’aval du parlement en novembre-décembre 2014 pour imposer un ensemble de mesures inspirées des politiques de « flexisécurité ». Elles comprennent notamment l’introduction d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à protection croissante, auquel le recours est encouragé par une importante baisse des charges sociales sur les entreprises, la facilitation des conditions de licenciement, l’amélioration de l’indemnisation et de l’accompagnement des chômeurs.
La nouvelle loi électorale renforçant le scrutin majoritaire (adoptée en mai 2015) et la réforme du Sénat (qui doit mettre fin au bicamérisme parfait) ont pour principal objectif d’apporter davantage de stabilité aux institutions italiennes. Mais, accusés par leurs détracteurs de déséquilibrer la démocratie au profit de l’Exécutif, ces projets suscitent de vives controverses d’ordre juridique et politique.
Deux ans après son intronisation, le gouvernement Renzi présente un bilan en demi-teinte. Le taux de chômage, dont celui des jeunes, tend à baisser, passant sous la barre des 12 % en 2015-2016 contre 12,7 % en 2014. De même, la dualité du marché du travail semble se réduire grâce à l’introduction du nouveau CDI, mais la réduction des prélèvements obligatoires ne s’est pas accompagnée de celle des dépenses publiques, et l’équilibre budgétaire, prévu en 2016, est reporté à 2018.
Dans un contexte de timide reprise économique (1 % après trois ans de récession), les élections municipales partielles de juin 2016, marquées par la présence de nombreuses listes civiques locales, se soldent par une percée de ces dernières et du Mouvement 5 étoiles (M5S) qui remporte notamment les mairies de Rome et de Turin face à la coalition de centre-gauche, le PD, contesté également à sa gauche, étant sanctionné dans une cinquantaine de communes importantes.
Ce désaveu se confirme par la suite alors que les oppositions de tout bord (Forza Italia, gauche du PD, Ligue du Nord et surtout M5S), aux motivations diverses, convergent contre le Premier ministre à l’occasion du référendum sur la réforme du Sénat le 4 décembre, M. Renzi s’étant engagé à démissionner en cas de rejet de son projet. Le « non » l’emporte ainsi à 60 %, entraînant le départ du chef du gouvernement – qui est remplacé par le ministre des Affaires étrangères Paolo Gentiloni – et ouvrant une nouvelle période de turbulences et d’incertitude.
Pour en savoir plus, voir l'article Italie
5. La démocratie italienne à l’heure de l’euroscepticisme et du populisme
Comme tendent à le montrer plusieurs enquêtes, la crise économique a probablement contribué à la montée de la défiance des Italiens à l’égard de l’Union européenne. Si l’opinion favorable à une sortie de la zone euro reste minoritaire, l’attachement à la monnaie unique s’est également émoussé. À cet euroscepticisme, en progression dans la plupart des pays de l’UE, s’est greffée la « crise migratoire » à partir de 2014-2016, qui a focalisé le débat politique.
Si elle est très surestimée dans les réponses aux sondages, la part des immigrés résidant en Italie est néanmoins passée de moins de 1 % en 1990 et de 2,2 % de la population en 2002 à 8,3 % en 2016. Atteignant 10-11 % dans le Nord et le Centre, mais autour de 5 % dans le Sud, elle est estimée à environ 10 % avec les demandeurs d’asile et les immigrés « clandestins ».
Environ la moitié des résidents étrangers sont européens (Roumains et Albanais en tête, suivis des Ukrainiens) devant les Africains (environ 22 %, dont 64 % d’Afrique du Nord et 36 % d’Afrique subsaharienne), les Asiatiques (env. 20 %) et les Sud-Américains (8 %).
L’insuffisante solidarité de l’UE à l’égard de l’Italie, en première ligne dans l’accueil des migrants et des réfugiés, a nourri les critiques adressées à Bruxelles et aux accords de Dublin. Malgré une forte chute des entrées à la suite d’accords, controversés et condamnés par les ONG humanitaires, passés en 2017 avec les autorités et les milices libyennes, l’immigration est devenue en quelques années l’une des principales préoccupations des électeurs, avec le chômage et la pression fiscale.
5.1. Les élections de mars 2018
La convergence des oppositions se confirme aux élections législatives de mars 2018, organisées selon un nouveau mode de scrutin mixte, combinant les systèmes majoritaire uninominal et proportionnel de liste.
Conduit par Luigi Di Maio, un jeune dirigeant plus « posé » que le tempétueux fondateur du mouvement B. Grillo, en retrait depuis 2014, le Mouvement 5 étoiles arrive en tête du scrutin avec plus de 32 % des voix, 222 sièges à la Chambre et 109 au Sénat. Il réalise ses percées les plus spectaculaires dans le sud de l’Italie : plus de 40 % des voix en moyenne et plus de 50 % à Naples. Se définissant comme ni de droite ni de gauche, le M5S, parti « attrape-tout » et « antisystème », est toujours hétérogène. Il est notamment divisé sur l’immigration et l’Europe.
De son côté, dirigée depuis son congrès de décembre 2013 par le très droitier Matteo Salvini, la Ligue du Nord obtient plus de 17 % des suffrages, 124 sièges à la Chambre et 58 au Sénat alors qu’on la croyait en reflux. Ayant fait de la question des migrants son principal cheval de bataille et devenue très critique à l’égard de l’UE, elle se présente sous le nom raccourci de « Ligue » dans le but d’élargir son audience à l’ensemble de la péninsule. La Ligue s’impose ainsi surtout dans les régions septentrionales (Lombardie et Vénétie en premier lieu avec plus de 20 et 30 % des voix), mais perce fortement en Émilie-Romagne (19 %) et dans le Centre – Toscane (17 %), Ombrie (20 %), Marches, Latium – et rallie même des électeurs plus au sud (12 % dans les Abruzzes).
L’alliance passée avec Forza Italia de S. Berlusconi (14 % des voix, 105 députés et 61 sénateurs) et le parti néofasciste Fratelli d’Italia (4,3 %) recueille au total 37 % des suffrages, 261 sièges à la Chambre et 137 au Sénat.
Avec 111 députés et 52 sénateurs, le PD (env. 19 % des voix, son plus mauvais résultat depuis sa fondation en 2007) est relégué à la troisième place.
Ce bouleversement est une nouvelle étape dans la recomposition politique à l’œuvre depuis les années 1990, mais ne donne pas une majorité claire au Parlement.
5.2. Un gouvernement « Ligue-5 étoiles »
Les négociations aboutissent finalement à la formation d’une coalition entre les deux principaux vainqueurs des élections après l’adoption d’un « contrat » de gouvernement. Si les positions les plus eurosceptiques sont adoucies ou passées sous silence, comme la question d’un éventuel référendum sur la sortie de la zone euro, le programme mêle les préoccupations environnementalistes et sociales du M5S et la ligne ouvertement xénophobe et sécuritaire de la Ligue.
Outre l’engagement écologique et la création d’un revenu minimum pour les plus pauvres (des exigences du M5S), il comprend ainsi un durcissement de la politique migratoire avec notamment l’accélération des expulsions des immigrés en situation irrégulière et la diminution des fonds alloués à l’accueil des réfugiés.
Sur le plan économique, une relance axée sur une importante réduction des impôts sur les entreprises et les ménages est envisagée. Parmi les mesures prévues figurent aussi, entre autres, la baisse de l’âge de départ à la retraite, un renforcement de la législation anti-corruption et des réformes institutionnelles favorisant la démocratie directe et les autonomies régionales.
Le financement de ce programme – dont le coût est estimé par certains à plus de 100 milliards d’euros – reste cependant flou. Son application pourrait compromettre la réduction du déficit et de la dette et, en remettant en cause le respect des traités européens, générer des tensions entre l’Italie et l’UE.
Sous la présidence de Giuseppe Conte, un juriste sans expérience politique – « encadré » par M. Salvini et L. Di Maio comme vices-Premiers ministres, à la tête respectivement des ministères de l’Intérieur et du « Développement économique, Travail et Politiques sociales » –, un gouvernement peut être formé ; il entre en fonctions en juin mais révèle d’emblée ses contradictions.
5.3. Du compromis à la rupture
Malgré la fragilité de la coalition au pouvoir, le gouvernement parvient à faire adopter certaines des mesures phares de son programme. Un premier décret-loi « sécurité et immigration », restreignant les droits et la protection des immigrés et réfugiés (suppression du séjour humanitaire notamment) ainsi que les conditions d’obtention de la nationalité italienne, est adopté en novembre 2018, suscitant les protestations des associations, les critiques de certains juristes et de l’opposition de gauche. Un second décret, entré en vigueur en juin 2019, est destiné notamment à renforcer les moyens de lutte contre l’immigration clandestine et vise directement les ONG venant au secours des migrants en mer. L’autre mesure prioritaire, voulue par le M5S, est la création du « revenu (et de la pension) de citoyenneté » à partir de mars 2019, mais après une restriction des conditions d’attribution dans le cadre d’un budget très critiqué par la Commission européenne et finalement révisé.
Les tensions entre les deux partenaires de la coalition s’accentuent cependant après les élections européenne et communales de mai-juin 2019 : en tête depuis plusieurs mois dans les sondages, la Ligue de M. Salvini confirme sa popularité et son ascension en progressant très fortement au niveau local, de 8 % en moyenne en 2014 à environ 20 % (dans les communes de plus de 15 000 habitants) et en triomphant aux européennes avec plus de 34 % des voix, devant le PD (22,7 %), le M5S (17 %), Forza Italia (8,7 %) et Fratelli d’Italia (6,4 %). La Ligue fait notamment une percée dans les régions du centre et dans les anciens bastions de la gauche.
Fort de ce succès qui inverse en sa faveur le rapport de force avec ses alliés, M. Salvini finit alors par mettre fin à la coalition au mois d’août en espérant provoquer de nouvelles élections législatives afin d’en tirer les bénéfices, mais il doit s’incliner à la suite du retournement d’alliance opéré par le Mouvement cinq étoiles.
5.4. Une nouvelle alliance
Tous deux en perte de vitesse et menacés en cas de scrutin anticipé, le M5S et le PD parviennent en effet à surmonter leurs désaccords pour former, en septembre 2019, un gouvernement de coalition sous la direction de G. Conte, qui a montré son indépendance lors de la crise gouvernementale. Approuvé par les militants du M5S, ce « front anti-Salvini » reste toutefois également très fragile et connaît une première déconvenue électorale en octobre à l’issue de l’élection régionale en Ombrie, où la candidate de la Ligue l’emporte avec plus de 57 % des voix.
La crise politique intervient dans un contexte économique très défavorable, avec des prévisions de croissance en baisse, que le gouvernement précédent voulait contrecarrer par un budget expansif et un report du retour à l’équilibre budgétaire.
À cet égard, si le nouveau cabinet PD-Cinq étoiles s’empresse de renouer avec les institutions européennes – par l’intermédiaire notamment du nouveau ministre pour les Affaires européennes et de Paolo Gentiloni, nouveau Commissaire aux Affaires économiques et financières –, il tente également de concilier les impératifs budgétaires (écartant cependant une augmentation de la TVA) et l’objectif de relance en reprenant les engagements en matière sociale et environnementale.