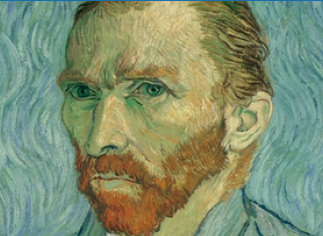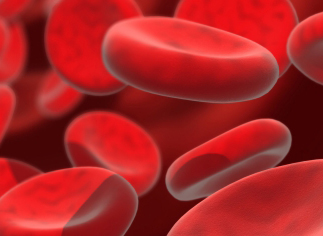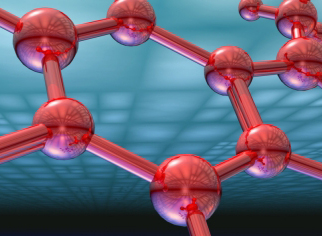Liban : histoire
Héritier de la Phénicie, point de convergence des civilisations de la Mésopotamie, de l'Égypte et de la Grèce, le Liban devient romain et byzantin avant d'être conquis par l'islam au milieu du viie siècle. Éternel refuge des minorités, il est constitué d'une mosaïque de communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes, et devient, durant les croisades, le siège d'un royaume chrétien, le royaume latin de Jérusalem. L'autorité de l'islam y est rétablie, à la fin du xiiie siècle, par les Mamelouks d'Égypte.
1. Le Liban sous la tutelle ottomane
Le Liban connaît ensuite, à partir du début du xvie siècle, une longue période de domination ottomane, malgré des tentatives d'unification et d'autonomie. La conquête du pays par Méhémet-Ali (1831), qui agit en véritable despote, provoque un sursaut national qui marque la véritable naissance de la nation libanaise. À la suite d'un massacre des maronites (une des principales communautés chrétiennes du pays, membre de l'Église maronite), un corps expéditionnaire français conduit par Beaufort d'Hautpoul, débarque en 1860 (campagnes de Syrie) et fait prévaloir des accords internationaux, qui, en 1861, garantissent l'autonomie du « Mont-Liban » à l'intérieur de l'Empire ottoman.
2. Le Liban sous mandat français (1922-1945)
Après la Première Guerre mondiale, la France reçoit en 1920 un mandat sur la Syrie et le « Grand-Liban », dont la capitale, Beyrouth, est la résidence du haut-commissaire de la République française (1920). Par l'acte de Londres du 24 juillet 1922, la Société des Nations (SDN) confirme à la France l'exercice de son mandat. La Constitution de 1926 fait du Liban une République parlementaire; réservant des pouvoirs forts au chef de l'État. Reconnue en 1936, l'indépendance libanaise sous mandat français est proclamée en 1941 et devient effective en 1945, après la Seconde Guerre mondiale.
3. Depuis l'indépendance
3.1. Le « pacte national » de 1943 et la fin de l'union douanière et économique syro-libanaise
Après l'évacuation du pays par les troupes françaises et britanniques, un système présidentiel et parlementaire « confessionnaliste » se met en place, instaurant le partage des pouvoirs entre les diverses communautés (« pacte national » non écrit de 1943, aux termes duquel la présidence de la République est attribuée à un maronite, celle du gouvernement à un musulman sunnite et la présidence de l'Assemblée à un chiite).
Dans le même temps, le Liban noue des relations privilégiées avec la France mais doit faire face à une rupture de son alliance avec la Syrie et, après le premier conflit israélo-arabe (guerres israélo-arabes), à l'arrivée massive de réfugiés palestiniens.
3.2. De délicats équilibres démographiques et religieux
Dès 1948, Ben Gourion déclare que le point faible de la coalition arabe est le Liban « car le régime y est artificiel et facile à saper ». Il faudrait, poursuit-il, « créer un État chrétien avec lequel nous pourrions faire alliance ». Ce petit pays montagneux et pauvre va donc devenir le lieu privilégié des affrontements incessants du Moyen-Orient, qui vont aggraver ses problèmes internes.
Des troubles interconfessionnels éclatent en mai 1958 et provoquent un débarquement américain en juillet. Sous les présidences de Camille Chamoun (1952-1958), du général Fouad Chehab (1958-1964) et de Charles Hélou (1964-1970), qui tentent successivement de renforcer l'autorité de l'État, la réorganisation administrative et le développement économique qui sont entrepris entraînent une croissance de 7 % par an et le Liban, îlot de libéralisme dans une région marxisante, bénéficie du boom pétrolier au point d'être qualifié de « Suisse du Moyen-Orient ».
Mais, après la guerre israélo-arabe de 1967, un nouvel afflux de 140 000 réfugiés palestiniens bouscule le fragile équilibre démographique entre chrétiens et musulmans, qui fondait la séparation des pouvoirs. Environ 500 000 Palestiniens, à 80 % sunnites, sont désormais installés au Liban et y créent des groupes de combat. Le 28 décembre 1968, un raid israélien détruit l'aviation civile libanaise sur l'aéroport de Beyrouth et la présence palestinienne devient l'enjeu majeur de la politique intérieure, provoquant des émeutes et une crise ministérielle de 7 mois (avril-novembre 1969).
3.3. Le Liban, caisse de résonance de tous les confits du Moyen-Orient
Sous l'égide de Nasser, les accords libano-palestiniens du Caire (novembre 1969) réglementent la présence palestinienne au Liban, notamment dans les camps du sud du pays. Mais le consensus interne est rompu et les structures étatiques, trop rigides pour évoluer, montrent leurs limites, d'autant que le contexte régional et international se mêle étroitement à la politique interne du Liban, faisant progressivement de celui-ci une caisse de résonancede tous les conflits de la région.
Entre 1970 et 1975, les crises politiques et sociales se multiplient. Des chefs palestiniens sont exécutés par Israël à Beyrouth (avril 1973), les miliciens palestiniens et l'armée libanaise s'affrontent, et le Liban rejoint le camp arabe dans la quatrième guerre israélo-arabe (octobre 1973). Des grèves insurrectionnelles éclatent (mars 1974) et de nouveaux raids israéliens ont lieu dans le sud du pays.
4. La guerre du Liban ou la mise entre parenthèses de l'État (1975-1990)
Dans cette atmosphère de crise éclate alors un conflit qualifié par certains de guerre civile ; d'autres y voient une action systématique (par milices mafieuses interposées) pour paralyser par la violence le fonctionnement de l'État et de la société civile et découper le territoire en ghettos communautaires. En fait, il ne s'agit pas d'un seul conflit, mais de plusieurs, qui s'interpénètrent, et dans lesquels les causes externes interfèrent sur les différends internes pour les aggraver et créer une situation si inextricable qu'elle va même donner naissance au vocable de « libanisation ».
4.1. Les débuts de la guerre
Ce conflit est dû à plusieurs phénomènes :
– la fragilité d'un État, régi par le principe du confessionnalisme, dépourvu d'une classe politique de qualité et dont l'indépendance n'a jamais été acceptée par la Syrie.
– les conflits régionaux, qui ont entraîné l'arrivée au Liban de nombreux réfugiés palestiniens depuis 1948. En 1975, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) était établie au Liban et dirigeait depuis ce pays des attaques contre Israël.
4.2. Renversements d'alliances
En avril 1975, les Phalanges libanaises, alliées des Occidentaux (fondées en 1936 par le maronite Pierre Gemayel), s'opposent aux Palestiniens et à la gauche libanaise (rassemblant le parti socialiste progressiste du chef druze Kamal Joumblatt, des membres du Baath et des communistes).
Les Phalanges sont mises en difficulté et demandent l'aide de la Syrie, qui envoie au Liban des troupes (elles resteront sur place jusqu'en 2005). Puis la Syrie abandonne les Phalanges pour s'allier aux Palestiniens et à la gauche libanaise. Israël se rapproche des Phalanges et, pour des raisons de sécurité, envahit le Sud du Liban en 1978.
4.3. Le tournant de 1982
Israël envahit en juin 1982 le reste du Liban et établit un blocus autour de Beyrouth. L'OLP et ses dirigeants, dont Yasir Arafat, quittent Beyrouth pour Tunis. Le chef des Phalanges, Bachir Gemayel, est élu président de la République en août 1982. Assassiné un mois plus tard, il est remplacé par son frère Amine. L'armée israélienne entre alors à Beyrouth. Elle autorise les phalangistes à pénétrer dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila où ils massacrent 1 500 réfugiés le 16 septembre 1982.
4.4. La fin de la guerre (1982-1989)
En 1983, Israël évacue Beyrouth. S'ouvre une période d'anarchie marquée par :
– l'apparition d'une milice chiite, le Hezbollah, favorable à l'Iran.
– la division du Liban en régions, dominées par les milices financées par les principaux acteurs régionaux.
À la fin du mandat d'Amine Gemayel en septembre 1988, il est impossible de désigner un autre président. Le général chrétien Michel Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, forme un gouvernement. Il lance en 1989 son armée contre les forces syriennes d'occupation, ce qui précipite la fin du conflit. Le 5 novembre 1989 sont signés les accords de Taif. La deuxième République libanaise est proclamée le 21 septembre 1990.
4.5. Un bilan très lourd
La guerre du Liban a coûté la vie de plus de 150 000 personnes (la population libanaise devait vraisemblablement compter 4 millions d'habitants au début des années 1990). À la fin du conflit, on compte 200 000 blessés et plus d'un million de personnes déplacées. Les destructions et les dégâts sont estimés à plus d'une vingtaine de milliards de dollars.
5. Le retour à la stabilité sous la tutelle syrienne
5.1. « Pax syriaca »
Durant l'année 1991, divers accords – englobant la sécurité autant que la politique, l'administration autant que l'économie – entérinent « une harmonisation », « une unité de destin et des intérêts communs » entre la Syrie et le Liban et définissent une forme de « finlandisation » s'apparentant à un protectorat syrien sur le Liban. Honnies par la population, les milices sont progressivement désarmées, à l'exception de celles du Hezbollah et de Amal. Ces dernières se déplacent vers le sud pour tenir tête aux Israéliens et à ses supplétifs – l'Armée du Liban-Sud –, qui occupent, depuis 1978, la zone de sécurité dans laquelle se concentrent désormais les combats armés, alternant inlassablement raids et bombardements en dépit de la présence de la Finul (dont le mandat est reconduit tous les 6 mois par l'ONU). Les autres miliciens entrent soit dans l'armée soit dans l'administration libanaise ; certains rejoignent le Canada ou l'Australie.
5.2. Rafic Hariri et la reconstruction (1992-1998)
Grands perdants du conflit, les chrétiens s'opposent à l'entente nationale sous contrôle syrien mise en place par l'accord de Taif et boycottent les élections législatives de 1992. Rafic Hariri, richissime homme d'affaires libano-saoudien et représentant de l'islam sunnite, devient président du Conseil sur le thème de la reconstruction du Liban, vu comme un élément de la recomposition régionale et comme un modèle de développement adapté à la mondialisation et à l'ouverture des marchés.
Relativement favorable, en dépit de quelques troubles en 1994, la situation est cependant freinée par l'évolution négative du processus de paix : amorcé par la conférence de paix sur le Proche-Orient ouverte à Madrid en octobre 1991, ce processus devait stabiliser la situation du Liban, restauré dans son rôle de place financière régionale. Entre 1992 et 1995, les indices attestent de la reprise de la croissance et des investissements, surtout dans la construction, grâce à des aides diverses (américaines, arabes, ou venant de la diaspora libanaise). Mais, à partir de 1995, la spirale de l'endettement domine : alors que les capitaux affluent et que des emprunts sont sans cesse contractés, le déficit budgétaire a augmenté de 105 % pour atteindre 37,5 % et le budget est consacré à 71 % au remboursement d'une dette sans cesse croissante. Le gouvernement est confronté à une paupérisation de la société (30 % des Libanais vivent au-dessous du seuil de pauvreté) et à une situation sociale devenue explosive en raison d'un taux de chômage de 20 % dans un pays qui accueille désormais 800 000 travailleurs immigrés dont 500 000 Syriens. Ces tensions d'ordre économique s'accompagnent d'une exacerbation du communautarisme : en donnant une écrasante majorité aux députés pro-syriens, les résultats des élections législatives de septembre 1996 suscitent l'inquiétude des chrétiens, alimentée en outre par la présence syrienne au Liban (malgré la reconstitution d'une armée de 48 000 anciens miliciens, 35 000 soldats et policiers syriens stationnent sur le territoire).
Dans le Sud, une tension permanente, avec des épisodes particulièrement alarmants (les opérations israéliennes « Règlements de comptes » le 25 juillet 1993 et « Raisins de la colère » le 11 avril 1996), est entretenue par les Syriens et les Israéliens, comme un élément de chantage et de négociation dans le cadre du conflit général du Proche-Orient, dont le Liban reste un des théâtres les plus brûlants.
En novembre 1998, le président Elias Hraoui arrive au terme de son mandat. Il est remplacé le 24 par Émile Lahoud. L'élection de ce général maronite, ancien chef de l'armée, confirme la disgrâce de R. Hariri à Damas. Ce dernier démissionne le 2 décembre 1998, jugeant anticonstitutionnelles les consultations du nouveau président avec les parlementaires pour la désignation du chef de gouvernement. Le 4, Selim al-Hoss lui succède à la tête du gouvernement.
6. Le Liban à la recherche de son émancipation (depuis 2000)
6.1. L'évacuation du Liban-Sud par Israël
Le départ des troupes israéliennes du Liban-Sud, en mars 2000, marque un tournant important. L'application de la résolution 425 (adoptée par le Conseil de sécurité en 1978) a été envisagée pour la première fois en 1998 par Benyamin Netanyahou (option dite « Liban libre »), qui exigea d'en négocier les modalités et le calendrier. Mais, refusant de se laisser imposer ses conditions par un ennemi plus fort que lui, le Liban avait alors catégoriquement refusé. Le successeur de Netanyahou, Ehoud Barak, fixe au 7 juillet 2000 la date à laquelle Tsahal se sera repliée du Liban-Sud, quelle que soit l'issue des pourparlers menés par Israël avec la Syrie. Or, l'effondrement de l'Armée du Liban-Sud (AL-S) sous la pression des miliciens du Hezbollah précipite les opérations : alors que les derniers soldats israéliens abandonnent, fin mai, de nombreuses positions dans la zone occupée, le délitement de l'AL-S laisse le champ libre au Hezbollah, qui investit aussitôt le terrain libéré, avec l'assentiment des autorités libanaises. Cependant, l'évacuation du Liban-Sud ne scelle pas la paix avec l'État hébreu : d'autres contentieux demeurent tels que ceux de l'eau, de la sécurité des frontières ainsi que le sort de quelque 200 000 réfugiés palestiniens au Liban.
Avec cette « libération » disparaît l'une des justifications de la présence syrienne au Liban. Le mois suivant, l'accession à la présidence de la Syrie de Bachar al-Asad, qui souhaite donner l'image d'un chef d'État moderne ouvert au dialogue, fait miroiter la possibilité de nouvelles relations entre les deux pays fondées non plus sur la domination mais sur la confiance. Mais, depuis, la Syrie ne semble plus rien vouloir céder.
6.2. Le retour de R. Hariri (2000-2004)
Lors du renouvellement de l'Assemblée en août-septembre 2000, les électeurs, sanctionnant l'incapacité du gouvernement Hoss à réaliser les réformes qu'il s'était fixées (lutte contre la corruption et réduction des inégalités sociales et du déficit budgétaire), votent massivement pour l'opposition, incarnée par R. Hariri et par le député druze W. Joumblatt, chef du parti socialiste progressiste (PSP). À la tête d'un gouvernement d'ouverture, incluant chiites, Druzes et maronites, R. Hariri se donne pour objectif de pacifier le climat politique et social, d'apurer les finances et de relancer l'économie.
Cependant, dès l'automne 2000, le Liban est à nouveau fragilisé par l'escalade de la violence israélo-palestinienne et l'arrivée d'Ariel Sharon au pouvoir en Israël. Dans ce contexte difficile, la question des réfugiés palestiniens présents sur le territoire libanais redevient particulièrement brûlante. En 2001, la tension militaire se focalise au lieu-dit « les Hameaux (ou Fermes) de Chebaa » – territoire syrien conquis par Israël en 1967 et non évacué en mai 2000 –, Tsahal ripostant par des bombardements aux attaques anti-israéliennes menées par le Hezbollah. En juin, la Syrie procède au redéploiement partiel de ses troupes stationnées à Beyrouth et dans sa banlieue, ainsi que dans certains secteurs de la montagne libanaise. Cette décision intervient après les demandes répétées des communautés maronite et druze d'appliquer une disposition prévue par l'accord de Taif (1989), et par le traité de coopération conclu deux ans plus tard entre Damas et Beyrouth. L'année 2001 est également marquée par une crispation autoritariste du pouvoir, comme en témoignent les rafles de 200 opposants chrétiens par les services de l'armée libanaise et l'amendement au Code de procédure pénale adopté par le Parlement au lendemain de la visite triomphale, fin juillet, du patriarche Nasrallah Boutros Sfeir dans la montagne druzo-chrétienne du Chouf, scellant la réconciliation des deux communautés minoritaires du pays, les maronites et les Druzes.
Qualifiée d'acte d'« agression » par l'ensemble de la classe politique libanaise, l'intervention américano-britannique en Iraq en mars 2003 pousse R. Hariri à présenter la démission de son gouvernement, qui est aussitôt remplacé par un nouveau cabinet, agréé par Damas et apte à faire face aux menaces américaines contre la Syrie.
À l'approche de l'élection présidentielle de novembre 2004, la Constitution libanaise est amendée, à titre provisoire et sur injonction syrienne, afin de permettre au président Lahoud d'obtenir une reconduction de son mandat pour une durée de trois ans. Ce coup de force de Damas intervient au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1559 – proposée par la France et soutenue par les États-Unis – qui met en garde contre toute ingérence dans le processus de l'élection présidentielle libanaise et réclame le départ de toutes les forces étrangères présentes dans le pays ainsi que le « démantèlement et le désarmement de toutes les milices, libanaises et non libanaises ». L'interventionnisme syrien est ouvertement contesté par R. Hariri, qui présente sa démission le 20 octobre, et par l'opposition, qui rejette le nouveau gouvernement prosyrien formé et dirigé par Omar Karamé.
6.3. La « révolution du Cèdre »
Le 14 février 2005, la mort de l'ex-président du Conseil, R. Hariri, et celle de vingt-deux personnes dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth suscite l'indignation au sein de la communauté internationale et au Liban, où elle entraîne un nouveau clivage entre loyalistes et opposants. À l'exception de la minorité chiite, fidèle à la ligne loyaliste prônée par ses deux principaux partis, Amal et Hezbollah, ce clivage ne recouvre pas celui des communautés. Piliers du camp loyaliste, le président du Conseil, le sunnite O. Karamé et son ministre de l'Intérieur, le maronite Soleiman Frangié, sont également rejoints par le parti démocratique libanais du Druze Talal Arslan. L'opposition, extrêmement morcelée, rassemble des formations chrétiennes telles que le Courant national libre du général Aoun (en exil en France), le parti des Forces libanaises aux côtés du PSP du Druze W. Joumblatt, le Bloc national libanais de Carlos Eddé, le Mouvement réformiste des Kataëb (issu d'une scission au sein des Phalanges) ou encore le parti national libéral (PNL) de l'ancien président C. Chamoun.
Au lendemain de l'assassinat de R. Hariri, les États-Unis et la France demandent au Conseil de sécurité des Nations unies une enquête internationale et le rétablissement de la souveraineté au Liban, tandis que des Libanais de toutes confessions défilent massivement dans les rues de Beyrouth aux cris de « Musulmans, chrétiens, ensemble contre les Syriens ». Après des funérailles nationales, l'opposition appelle à un « soulèvement de l'indépendance » et, imputant la responsabilité de l'attentat au « système sécuritaire syro-libanais », elle réclame le départ du gouvernement et le retrait des 14 000 soldats syriens stationnés sur le sol libanais.
Le 8 mars, à l'appel du dirigeant du Hezbollah, Hasan Nasrallah, plusieurs centaines de milliers de loyalistes manifestent leur soutien à Damas et leur rejet de la résolution 1559. Le 14, l'opposition appelle les Libanais de toutes confessions (près d'un million de manifestants se rassemblent sur la place des Martyrs) à exiger la vérité sur l'assassinat de R. Hariri. Après avoir annoncé un redéploiement de ses forces dans l'est du Liban, sans en préciser la date, la Syrie achève le retrait précipité de ses troupes le 26 avril. Démissionnaire une première fois, le 28 février, désigné deux semaines plus tard pour former un nouveau cabinet, O. Karamé finit par jeter l'éponge le 30 mars, après avoir essuyé le refus de l'opposition de participer à un gouvernement d'union nationale.
Najib Mikati, homme d'affaires et ancien ministre proche de la Syrie, mais soutenu par l'opposition, est désigné à la tête d'un gouvernement de transition chargé de garantir les nouvelles élections.
6.4. Le retour au confessionnalisme
Les élections législatives se déroulent en quatre étapes, du 29 mai au 20 juin 2005. Les votes se répartissent selon les clivages confessionnels. Dénommée « courant du 14 mars » (en référence aux manifestations du 14 mars 2005), la coalition antisyrienne – forte d'une dizaine de formations, dont le Courant du futur du député Saad Hariri, fils de l'ex-président du Conseil assassiné, le PSP de W. Joumblatt, les Forces libanaises et le groupe dit « de Kornet Chehouane » qui rassemble le parti des Kataëb et des indépendants – remporte la majorité absolue au sein du nouveau Parlement avec 72 sièges sur 128. Sous l'appellation de « Bloc de la résistance et du développement », l'opposition prosyrienne rassemble désormais les partis chiites Amal et Hezbollah et leurs alliés. Mais le Courant patriotique libre (CPL) du général Aoun, rentré d'exil peu auparavant, obtient 21 sièges – un score inattendu, qui bouleverse l'échiquier politique libanais – et se rallie à ses anciens adversaires, signant une entente avec le Hezbollah en février 2006.
Symbole de l'ingérence syrienne au Liban, Nabih Berri, leader de Amal, est réélu (pour la quatrième fois) à la présidence du Parlement. Un proche de R. Hariri, l'ancien ministre des Finances Fouad Siniora devient président du Conseil. Il dirige un cabinet composé à parts égales de chrétiens (à l'exception du CPL du général Aoun, dont les visées sont présidentielles) et de musulmans. Le Hezbollah, qui souhaite consolider son intégration politique, y détient deux ministères.
Le rapport de la commission d'enquête de l'ONU (remis à Kofi Annan par le juge allemand Detlev Mehlis) sur l'attentat ayant coûté la vie à R. Hariri met en cause – s'appuyant sur des « preuves convergentes » – l'implication de la Syrie et des autorités libanaises dans cet acte terroriste. À l'occasion de la mort du député Gébrane Tueini, farouche opposant au régime syrien tué dans un attentat le 12 décembre 2005 (le quatorzième depuis un an), le gouvernement libanais demande au Conseil de sécurité l'ouverture d'une enquête internationale et la création d'un tribunal international sur l'assassinat de R. Hariri.
Le « dialogue national », entamé en mars 2006 par les principales formations politiques libanaises, permet d'obtenir, fin juin, un accord sur quatre points : le refus de toute présence armée palestinienne hors des camps de réfugiés, l'établissement de relations amicales avec la Syrie, la reconnaissance de l'identité libanaise des « Hameaux de Chebaa », la formation d'un tribunal « à caractère international ». Les discussions achoppent sur une double impasse : celle de la démission du président de la République et celle du désarmement du Hezbollah.
6.5. Le Liban pris au piège du conflit entre le Hezbollah et Israël
Le dialogue interlibanais est soudainement interrompu le 12 juillet par l'enlèvement de deux soldats israéliens à la frontière israélo-libanaise par un commando du Hezbollah. La résistance de la milice chiite aux incursions israéliennes vaut au Liban de subir la plus agressive des ripostes lancées depuis 1982 par l'État hébreu. Initialement concentrée sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, la vague de bombardements israéliens s'étend à l'ensemble du territoire libanais et provoque un champ de ruines : plus de 1 300 morts, près de 4 000 blessés, 1 million de personnes déplacées, des infrastructures civiles détruites. Réuni en urgence à la demande du gouvernement de F. Siniora, qui récuse toute responsabilité dans cet acte unilatéral du Hezbollah, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le 11 août la résolution 1701, exigeant une cessation immédiate des hostilités (un cessez-le-feu intervient le 14 août), demandant le déploiement de l'armée libanaise et des forces de la Finul (dont l'effectif est renforcé) dans le sud du pays, entre le fleuve Litani et la « ligne bleue », ainsi que le retrait parallèle des forces israéliennes.
Lors de l'achèvement du retrait israélien le 1er octobre, les principaux contentieux subsistent : les deux soldats israéliens enlevés n'ont pas été libérés ; le statut des Hameaux de Chebaa n'a connu aucune avancée. Sur la scène intérieure libanaise, le Hezbollah – dont le réarmement via la frontière libano-syrienne ne fait plus aucun doute – est devenu un État dans l'État.
6.6. L'impasse politique et le coup de force du Hezbollah
Fort de la légitimité acquise pour sa résistance à Israël, le Hezbollah exige un gouvernement d'union nationale au sein duquel il détiendrait une minorité de blocage ; exigence par la suite surenchérie par celle d'un gouvernement de transition chargé d'élaborer une nouvelle loi électorale. Le 11 novembre, avant-veille de l'adoption de deux documents relatifs à la création d'un tribunal à caractère international, la rupture est consommée avec la démission des 5 ministres chiites. S'ouvre alors une longue polémique sur la légitimité constitutionnelle du gouvernement Siniora. Selon l'opposition, le Liban doit être gouverné avec le consensus des communautés les plus importantes ; les chiites n'étant plus au gouvernement, ce dernier est illégitime. Selon le « courant du 14 mars », le gouvernement jouit de la légitimité électorale que lui a donnée la majorité au Parlement. Ces divisions sont exacerbées par l'assassinat, le 21 novembre, de Pierre Gemayel, ministre de l'Industrie et fils de l'ancien président A. Gemayel. À partir du 1er décembre, des centaines d'opposants prosyriens campent dans le centre de Beyrouth pour obtenir la démission du gouvernement Siniora.
Tout au long de l'année 2007, les médiations engagées par la Ligue arabe échouent à rapprocher les parties. Le « courant du 14 mars » accuse l'opposition d'être au service de l'Iran et de la Syrie et de trahir les intérêts du pays ; l'opposition renvoie l'accusation en traitant la coalition au pouvoir d'instrument de la politique américaine puis, après l'adoption le 30 mai de la résolution 1757 imposant la création d'un tribunal « à caractère international », de soumettre le pays à la loi de l'étranger. Alors que la recrudescence des violences fait planer la menace d'affrontements confessionnels et de guerre civile, l'armée – ultime symbole de l'unité du pays dans sa diversité – devient l'institution la plus populaire, notamment au lendemain de sa victoire obtenue, après plusieurs mois de siège (mai-septembre 2007) et malgré son sous-équipement, sur le Fatah al-Islam, un mouvement armé implanté dans le camp de Nahr al-Bared et revendiquant une affiliation avec al-Qaida.
Pendant l'été, les divergences, reflet des tensions interrégionales, sur l'élection du nouveau président de la République plongent le pays dans une crise institutionnelle. Depuis le 24 novembre 2007, date de l'expiration du mandat de É. Lahoud, la fonction présidentielle est vacante malgré l'afflux des émissaires étrangers et la feuille de route présentée en janvier 2008 par la Ligue arabe pour aider le pays du Cèdre à sortir de la crise. Début mai, le Hezbollah prend par la force le contrôle de Beyrouth-Ouest, fief de la majorité sunnite, et de la montagne druze. Les combats s'étendent à Tripoli et à Halba, au nord du Liban, et dans le Chouf. L'armée reste neutre par crainte d'une scission communautaire en son sein. Le 14 mai, après la fin des combats qui ont fait plus de 60 victimes, le gouvernement annule les deux décisions prises à l'encontre du Hezbollah qui avaient été à l’origine des hostilités.
6.7. Vers une sortie de crise ?
Grâce à une médiation de la Ligue arabe et du Qatar entamée le 10 mai 2008, majorité et opposition réunis à Doha acceptent de reprendre le dialogue et parviennent le 21 mai à un compromis prévoyant l'élection immédiate d'un président de la République, la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé, pendant l'unique année de son mandat, de préparer les élections législatives du printemps 2009. En vertu de l'accord de Doha, le général Michel Sleiman, commandant en chef de l'armée depuis 1998 et unique candidat de consensus adoubé par l'opposition et la majorité, est élu à la tête de l'État le 25 mai par 118 voix sur 127. Au terme de laborieuses tractations, un gouvernement d'union nationale est formé le 11 juillet, sous l'autorité de F. Siniora. L'autonomie militaire du Hezbollah – question-clé qui oppose majorité et opposition – figure parmi les priorités devant être débattues au sein d'une conférence de dialogue national.
L'année 2008 est également marquée par l'établissement de relations diplomatiques entre le Liban et la Syrie pour la première fois depuis l'indépendance des deux pays il y a plus de 60 ans.
Les élections législatives du 7 juin 2009 sont remportées par la coalition du « 14 mars » entre sunnites, chrétiens (Forces libanaises et Kataëb) et druzes (PSP de W. Joumblatt) autour du Courant du Futur de Saad Hariri, qui, avec 71 sièges sur 128, conserve la majorité absolue ; 57 sièges reviennent aux forces du « 8 mars » qui rassemblent le Hezbollah, le mouvement Amal et ses alliés druze (T. Arslan) et chrétien, notamment le Courant patriotique libre (CPL) de Michel Aoun. Peu après la réélection de Nabih Berri (dirigeant chiite du parti Amal) à la tête du Parlement pour un 5e mandat consécutif, ce dernier élit Saad Hariri à la tête du futur gouvernement. Au terme de cinq mois de blocages et de tractations autour de la répartition des portefeuilles ministériels entre majorité et opposition, Saad Hariri parvient, le 9 novembre, à former un gouvernement « d'union nationale ».
Le début des travaux du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), créé à La Haye en 2007 sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies et chargé de poursuivre les personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ex-président du Conseil Rafic Hariri ainsi que celle de 22 personnes, ravive les tensions communautaires. Ses partisans – principalement issus de la communauté sunnite – attendent du tribunal qu'il identifie les responsables de l’attentat et mette ainsi un terme à l'impunité des assassinats politiques. Le Hezbollah ainsi qu'une partie des Druzes et des chrétiens maronites contestent en revanche la légitimité du TSL, accusant celui-ci d'être à la solde des États-Unis et d'Israël et de vouloir diviser les Libanais.
En janvier 2011, face au refus de S. Hariri de désavouer le TSL, l'organisation chiite retire ses ministres de la coalition, provoquant la chute de cette dernière. Bénéficiant aussitôt après du ralliement de Walid Joumblatt, qui s’est déjà éloigné du courant du futur et de l’alliance du « 14 mars » pour adopter une position « centriste », le Hezbollah, disposant désormais de la majorité requise, prend le contrôle du Parlement et voit son candidat, le milliardaire sunnite Najib Mikati soutenu par 68 députés sur 128, désigné pour former le prochain gouvernement. En juin 2011, au terme de cinq mois de difficiles négociations, le Hezbollah et ses alliés, à qui 19 postes ministériels sur 30 ont été attribués, se retrouvent en position de force.
6.8. Le conflit syrien et la paralysie politique
Les tensions politiques réapparaissent cependant à l’occasion de la préparation des élections législatives prévues en juin 2013 et conduisent à la démission du Premier ministre N. Mikati en mars. Portant principalement sur l’adoption d’une nouvelle loi électorale, le litige est toutefois éclipsé par la gravité de la situation régionale et le scrutin est reporté.
La guerre civile en Syrie menace en effet de déborder au Liban, où plus de 500 000 Syriens ont trouvé refuge depuis le début du conflit. Le président Sleiman tente de faire respecter la neutralité libanaise mais la situation en Syrie oppose les principaux partis : alors que le Hezbollah soutient le régime de Bachar al-Asad, certaines composantes de l’alliance du « 14 mars » (et W. Joumblatt), ont pris le parti des rebelles. Si ces derniers peuvent utiliser des localités libanaises acquises à leur cause comme base arrière, dans le camp adverse, les milices chiites du Hezbollah s’engagent pleinement au côté du régime syrien. Sollicité par l’allié iranien et reconnu ouvertement par leur chef Hassan Nasrallah, l’appui du Hezbollah est ainsi précieux lors de la reprise par l’armée syrienne de la ville stratégique de Qoussayr (dans le sud de Homs, non loin de la frontière libanaise) en juin 2013.
Le territoire libanais n’échappe pas aux risques de déstabilisation : outre des heurts meurtriers opposant sunnites et alaouites libanais à Tripoli depuis ceux de mai-août 2012, des bombardements sporadiques attribués à l’armée syrienne, ont lieu à partir de mars 2013 sur des zones frontalières pouvant servir de points de passage entre les deux pays pour les réfugiés, les armes et les rebelles. La situation se tend encore dans les mois suivants, avec plusieurs attentats dont certains revendiqués par des groupes liés à al-Qaida.
C’est dans ce climat extrêmement tendu et menaçant pour les équilibres très fragiles du Liban que Tammam Salam, personnalité consensuelle, parvient finalement à former un gouvernement d’intérêt national le 15 février 2014. Basé sur l’équilibre entre tous les courants politiques et la rotation, le nouveau cabinet comprend 24 ministres dont les portefeuilles sont répartis à égalité entre l’alliance du « 14 mars », celle du « 8 mars » et les forces dites « centristes ». La paralysie institutionnelle ne prend pas pour autant fin : depuis l’expiration du mandat de Michel Sleiman le 25 mai, le poste de président de la république demeure vacant faute d’un accord entre parties au sein du Parlement. Les élus du groupe parlementaire de Michel Aoun (bloc du Changement et de la Réforme dominé par le Courant patriotique libre [CPL]) et les députés du Hezbollah boycottant les séances, le quorum nécessaire pour cette élection ne peut jamais être atteint.
Ce n’est que le 31 octobre 2016 que la situation peut être débloquée à l’issue de la 46e séance consacrée à cette tâche. L’assentiment de l’Arabie Saoudite et de l’Iran contribue en coulisse à cette issue et, fort du soutien ou du ralliement du Hezbollah de H. Nasrallah, de Saad Hariri et du Courant du Futur, du PSP de Walid Joumblatt, ainsi que des Forces libanaises de Samir Geagea, M. Aoun est élu président de la République avec 83 voix sur 127.
En décembre, à l’issue de nouvelles tractations, S. Hariri prend la tête d’un gouvernement regroupant l'ensemble de l'éventail politique (à l'exception du parti des Kataëb) dans l’attente des élections.
6.9. Les élections de 2018
Neuf ans après les dernières élections législatives et au terme de cinq ans de tensions, un nouveau scrutin a finalement lieu en mai 2018. Outre la baisse du taux de participation (de 54 % à 49,7 %), il se solde par une recomposition conjoncturelle des forces politiques au sein du Parlement, élu selon le nouveau système proportionnel avec vote préférentiel adopté en 2017 sans remise en cause de l’équilibre confessionnel.
Desservi par le nouveau mode de scrutin, le Courant du futur du Premier ministre S. Hariri, qui est toujours à la tête du gouvernement après avoir démissionné sous la pression de l’Arabie saoudite puis retrouvé son poste en novembre-décembre 2017, recule (notamment à Tripoli au profit de la liste conduite par l’ancien Premier ministre Najib Mikati), en perdant environ un tiers de ses députés. Tout en restant la première formation dans la communauté sunnite, il est devancé par le CPL, qui demeure le premier bloc chrétien à la Chambre, tandis qu’Amal et le Hezbollah font le plein des voix chiites. La surprise de ces élections vient surtout du résultat obtenu par les Forces libanaises qui doublent le nombre de leurs sièges. Quant au mouvement « de la société civile » né dans le sillage de la « crise des déchets » de 2015 et qui avait tenté de brouiller la logique communautaire de la vie politique aux élections municipales de 2016, il n’obtient que de maigres résultats, la liste Koullouna Watani ne parvenant à faire élire qu’un candidat sur les 66 présentés.
En janvier-février 2019, un troisième gouvernement d’« union nationale », sous la direction de S. Hariri, peut être formé. Sa priorité, annoncée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, est la mise en œuvre des réformes économiques présentées aux bailleurs de fonds lors de la Conférence économique Cedre, tenue à Paris en avril 2018.